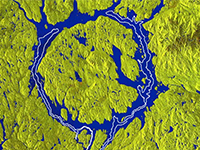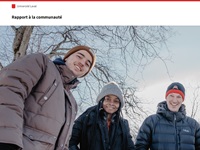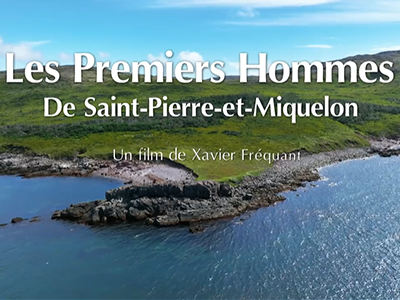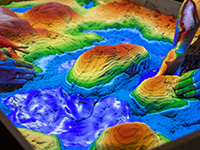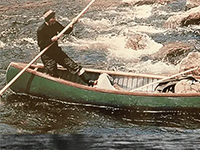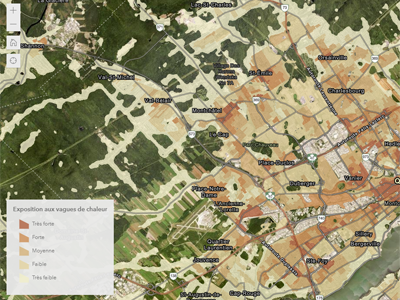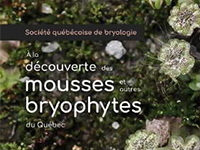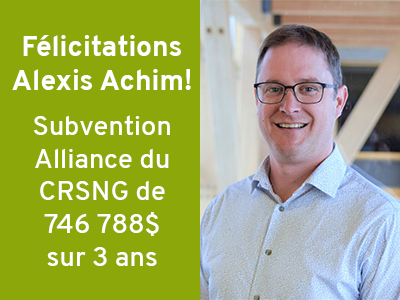Actualités
Michel Allard nommé au sein du groupe d’experts sur l’adaptation aux changements climatiques
19 décembre 2023
Michel Allard, professeur émérite du Département de géographie a été choisi au sein du groupe d’experts qui conseillera le gouvernement québécois sur l’adaptation aux changements climatiques.
La composition du groupe d’experts qui conseillera le gouvernement québécois sur l’adaptation aux changements climatiques a été annoncée. Alain Webster, président du Comité consultatif sur les changements climatiques et Alain Bourque, directeur général d’Ouranos, les deux coprésidents nommés par le ministre Benoit Charette, ont mis en place «une équipe pluridisciplinaire d’experts reconnus ». «Les membres de ce groupe, soigneusement sélectionnés par les co-présidents, incarnent l’excellence dans leurs domaines respectifs. Le rapport final du groupe proposera des recommandations en vue d’une analyse approfondie des risques à l’échelle du Québec, accompagnée d’avis concrets destinés à orienter nos politiques publiques», a indiqué le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, dans un communiqué.
Source: Stéphane Blais, La Presse Canadienne, "Climat: le nouveau groupe d’experts du gouvernement est maintenant connu",
Félicitations aux récipiendaires du concours cartographique La preuve par la carte!
10 décembre 2023
Le concours cartographique La preuve par la carte a de nouveau été présenté cette année dans le cadre de la Journée SIG Université Laval.
Plusieurs personnes se sont distinguées et on remporté des prix offerts par nos partenaires Coop Zone et le Centre de recherche en données et intelligence géospatiales (CRDIG) :
- Audrey Plantegenêt, étudiante en technologie de la géomatique (Cégep Limoulou) : 1er prix, catégorie Point de vue de cartographe (50$ du CRDIG).
- Jimmy Bélanger, étudiant en technologie de la géomatique (Cégep Limoulou) : 1er prix, catégorie Point de vue d'artiste (50$ du CRDIG).
- Laura-Lee Bolger, graduée de la maîtrise en sciences géographiques (Université Laval) : 1er prix, catégorie Carte dynamique (50$ du CRDIG).
- Alexandre Olivier, étudiant au baccalauréat en chimie (Université Laval) : prix du public (50$ en chèques-cadeaux Coop Zone).
Pour admirer les oeuvres : Concours cartographique La preuve par la carte.
Félicitations aux récipiendaires et merci à toutes les participantes et tous les participants!
Un grand merci à nos partenaires!
Pour revivre la Journée SIG Université Laval 2023 : Édition 2023.
Évelyne Thiffault, récipiendaire du Prix d’excellence en enseignement pour l’année 2023
07 décembre 2023
L’Université Laval a dévoilé hier les noms des membres de son corps professoral et de son personnel enseignant qui ont remporté un Prix d’excellence en enseignement pour l’année 2023.
Félicitations à notre estimée collègue Évelyne Thiffault, professeure au Département des sciences du bois et de la forêt, qui reçoit le Prix Distinction en enseignement pour les professeures et les professeurs, qui s’accompagne d’une bourse de 4 000 $. En savoir plus sur son engagement en enseignement.
À l'occasion de la cérémonie de reconnaissance annuelle présidée par la rectrice, Sophie D’Amours, et la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé, Cathia Bergeron, plus de 28 000 $ en fonds de développement pédagogique ont été remis aux lauréates et aux lauréats de ce concours prestigieux.
« C’est toujours avec beaucoup de fierté que nous reconnaissons l’excellence au sein de notre établissement en attribuant des Prix d'excellence en enseignement. Par ce geste, l'Université Laval souhaite promouvoir la qualité de l'enseignement au sein de la communauté enseignante, inciter ses facultés et ses unités à participer à la valorisation de l'enseignement en présentant des candidatures exemplaires et se distinguer en matière de pédagogie universitaire », a déclaré la vice-rectrice aux études et aux affaires étudiantes, responsable de la santé, Cathia Bergeron.
« Félicitations aux lauréates et aux lauréats de l’édition 2023. Excellence, engagement, créativité et innovation : voilà des mots qui vous caractérisent. Vous êtes des personnes passionnées par la pédagogie. Par votre savoir-faire et votre savoir-être, vous contribuez jour après jour à la qualité de la formation. Votre enseignement a le pouvoir de faire une différence auprès de nos étudiantes et étudiants et d’influencer de façon durable leur parcours. Enseigner, c’est transmettre des connaissances, mais c’est aussi accompagner vers la réussite, une mission essentielle à l’Université Laval », a déclaré la rectrice de l’Université Laval, Sophie D’Amours.
Depuis sa création en 1997, ce concours reconnaît la contribution exceptionnelle de professeures et de professeurs, de chargées et de chargés de cours et d’enseignement ainsi que de responsables de formation pratique qui transmettent avec brio leur passion et leurs connaissances, en plus de contribuer au rayonnement de leur faculté et de l'Université Laval tout entière. Il met également en lumière l’excellence de leur pratique pédagogique ainsi que leur engagement, leur créativité et leur sens de l’innovation, de même que la qualité des équipes qui les accompagnent dans leur démarche pédagogique.
Les lauréates et lauréats 2023 :
Charles-Olivier Amédée-Manesme, professeur titulaire
Faculté des sciences de l’administration, Département de finance, assurance et immobilier
Prix Cours à distance, hybride ou comodal (2 000 $)
François Ratté, professeur titulaire
Faculté de médecine, Département de médecine de famille et de médecine d'urgence
Prix Ressource pédagogique (2 000 $)
Antoine Pellerin, professeur agrégé
Faculté de droit
Josée Proulx, responsable de formation pratique
Service du développement professionnel
Prix Formation continue (2 000 $)
Darren Edward Richard, professeur titulaire
Faculté de médecine, Département de biologie moléculaire, de biochimie médicale et de pathologie
Prix Direction de programme (2 000 $)
Jean-Frédéric Morin, professeur titulaire
Faculté des sciences sociales, Département de science politique
Prix Encadrement aux cycles supérieurs (2 000 $)
Pierre-Olivier Roy, chargé d'enseignement
Faculté de musique
Prix Distinction en enseignement pour les personnes chargées de cours, les responsables de formation pratique, les personnes chargées d’enseignement en médecine et les professeures et les professeurs de clinique (4 000 $)
Évelyne Thiffault, professeure agrégée
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Département des sciences du bois et de la forêt
Prix Distinction en enseignement pour les professeures et les professeurs (4 000 $)
Denis Simard, professeur titulaire
Faculté des sciences de l'éducation, Département d'études sur l'enseignement et l'apprentissage
Prix Carrière en enseignement (10 000 $)
Source : Relations médias de l'Université Laval
Des chercheurs découvrent le lac le plus profond du Québec
06 décembre 2023
Une étude menée par une équipe de l’Université Laval a permis d’établir que le titre de lac le plus profond du Québec peut être revendiqué par le lac Manicouagan. Ce nouveau champion a une profondeur maximale de 320 mètres, soit 40 mètres de plus que le précédent record. Il est toutefois inutile d’espérer se rendre sur ses rives pour le contempler ou pour le prendre en photo puisqu’il se trouve au fond du réservoir Manicouagan.
« Le réservoir Manicouagan a été mis en eau dans les années 1960 à la suite de la construction du barrage Daniel-Johnson, rappelle le responsable de l’étude, Patrick Lajeunesse, professeur au Département de géographie de l’Université Laval et chercheur au regroupement Québec-Océan. Auparavant, on trouvait dans cette région deux lacs en forme d’arc, d’une longueur d’environ 60 km chacun, qui se faisaient face : le lac Mouchalagan et, 70 km à l’est, le lac Manicouagan. »
Ces deux lacs étaient situés de part et d’autre d’un cratère formé il y a 214 millions d’années par la chute d’une météorite. « La hausse du niveau d’eau qui a suivi la construction du barrage a fait en sorte que les rives de ces deux lacs se trouvent maintenant à plus de 130 mètres sous la surface du réservoir, explique le chercheur. L’eau contenue dans le réservoir a atteint les bourrelets du cratère météoritique, mais le rebond central du cratère n’a pas été inondé. C’est ce qui a formé l’île René-Levasseur. Sur les photos satellites, l’ensemble a l’allure d’un œil géant. Certains le désignent d’ailleurs comme "l’œil du Québec". »
L’équipe du professeur Lajeunesse a utilisé le bateau de recherche Louis-Edmond-Hamelin pour effectuer des relevés dans la partie du réservoir située au-dessus du lac Manicouagan. À l’aide de données accumulées au fil de plusieurs centaines de kilomètres de transects, ils ont dressé le profil bathymétrique détaillé du lac.
« La couche de sédiments du lac Manicouagan est exceptionnellement épaisse et atteint 280 m par endroits, explique le professeur Lajeunesse. On pense qu’en raison de la profondeur du lac, les sédiments n’auraient pas été perturbés lors des dernières glaciations. En théorie, on pourrait donc utiliser ces sédiments comme archives pour étudier les changements climatiques, les changements environnementaux et les séismes survenus depuis des centaines de milliers d’années. »
Des relevés effectués à l’aide d’un échosondeur multifaisceaux ont permis aux chercheurs de visualiser ce qui se trouve aujourd’hui au fond du réservoir. « On voit distinctement des arbres et des arbustes toujours debout, des ruisseaux, des plages, des paysages tels qu’ils étaient avant la mise en eau, comme si le temps s’était arrêté, constate le professeur Lajeunesse. Si nous avions les ressources, nous pourrions faire de la cartographie à haute résolution et utiliser des robots sous-marins pour étudier les habitations saisonnières que les Innus de Pessamit avaient établies sur les rives du lac Manicouagan. Nous pourrions ainsi contribuer à enrichir les connaissances sur l’héritage culturel de cette communauté. »
Les détails de cette étude viennent de paraître dans la revue Geomorphology. Les signataires de l’étude sont Léo Chassiot, Patrick Lajeunesse, François-Xavier L'Heureux-Houde et Jean-François Bernier, de l’Université Laval, et leurs collègues allemands Kai-Frederik Lenz et Catalina Gebhardt.
Photo : Le lac Manicouagan était situé du côté est du réservoir Manicouagan. La ligne blanche en délimite les anciennes rives. Un autre grand plan d'eau, le lac Mouchalagan, se trouvait du côté ouest du réservoir. Les deux lacs sont disparus après la mise en eau du réservoir dans les années 1960, par Pierre Markuse
Source : Université Laval
Les bons coups de la Faculté dans le rapport à la communauté de l'Université Laval.
27 novembre 2023
L'Université Laval a publié à la mi-novembre son rapport annuel à la communauté. Survol de l'impulsion qui anime l'Université Laval, le Rapport à la communauté 2022-2023 renferme plus d'une cinquantaine d'histoires et de projets porteurs. Ce rapport témoigne de la vitalité de l'Université et met la lumière sur des personnes engagées à relever des défis et à préparer l'avenir.
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique fait partie de ces histoires inspirantes. En voici quelques-unes:
Expérience d'apprentissage sensorielle en 3D
Sylvie Daniel et Willian Ney Cassol, professeurs au Département des sciences géomatiques, ont récemment mis en place un nouveau laboratoire expérientiel (labEx), qui a pour objet d’intérêt la REPrésentation 3D et la PERception 3D dans les environnements physiques d’où son nom de laboratoire REPER 3D.
La mise en place du laboratoire est motivée par plusieurs objectifs liés à la formation, à la recherche et à l’innovation, à l’expérience étudiante, à la visibilité et au dynamisme du Département. Ceci montre encore la volonté de l’UL d’utiliser des moyens innovants pour la formation de nos étudiantes et étudiants mais aussi pour la recherche. Le labEx REPER 3D s’appuiera sur une maquette d’un environnement urbain miniaturisé personnalisable (ex. plateaux modulaires incluant des routes, intersections, panneaux de signalisation, feux de signalisation, …) et peu coûteuse, qui sera complétée par des petits drones et de nouveaux capteurs imageurs permettant de proposer des expériences d'apprentissage de pointe et de mener des recherches en perception et représentation 3D sous l’angle de l’intégration de capteurs, la télédétection, la photogrammétrie, l’intelligence artificielle, la modélisation 3D et de la visualisation 3D. La maquette urbaine, les drones et capteurs miniaturisés permettront de créer un contexte de formation et de recherche qui expose aux conditions du monde réel (bruits, variabilité, informations partielles, …) tout en préservant le contrôle des environnements.
Nouveau Consortium de recherche sur les panneaux composites à base de bois
La création du nouveau Consortium de recherche sur les panneaux composites à base de bois (Corepan-bois) permettra la valorisation des résidus de bois, l’optimisation des procédés de fabrication des panneaux et le développement de nouveaux produits. Les chercheurs identifieront de nouvelles sources durables d’approvisionnement en fibres issues de la biomasse forestière, urbaine et agricole. Ils développeront aussi de nouveaux adhésifs biosourcés ou issus de résidus de procédés de transformation industriels. Ce consortium montre bien l’ouverture de l’Université Laval et sa capacité à travailler en collaboration car il regroupe deux universités, un centre collégial de transfert de technologie, un organisme de recherche et de développement privé à but non lucratif et quatre fabricants de panneaux composites.
L’industrie canadienne de panneaux occupe le quatrième rang mondial et c’est un domaine très concurrentiel où il faut constamment innover pour rester dans la course. L’industrie québécoise est la plus productive au Canada dans ce domaine. La mission de recherche de l’Université Laval est très importante afin d’aider à varier les sources de matière première, améliorer la productivité mais aussi par l’enseignement afin de fournir du personnel hautement qualifié à cette industrie. Ceci montre son rôle de leader en matière de recherche en génie du bois et des matériaux biosourcés.
Lisez l'article et visionnez le lancement
Nouvelle carte interactive de la vulnérabilité de la population canadienne aux vagues de chaleur accablante
Une équipe du Département de géographie a produit une toute première carte interactive web, à l’échelle du Canada, de la vulnérabilité et de l’exposition de la population aux vagues de chaleur accablante. Cet outil est disponible tant pour le grand public que pour les professionnels et les décideurs dans le domaine de l’aménagement, de l’urbanisme et de la santé publique. Ce projet montre comment l’expertise de l’Université Laval peut servir à la grandeur du Canada face aux enjeux des changements climatiques en fournissant des outils permettant de mieux cibler les zones à risque face à la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur mettant une pression sur la santé de la population. La chaleur accablante tue plus de personnes chaque année au pays que tout autre événement météorologique.
Les autorités locales, régionales et provinciales ont à faire face aux conséquences sanitaires, sociales et économiques engendrées par les changements climatiques. Grâce à l’information mise à leur disposition par le biais de la cartographie interactive, elles seront en mesure d’intervenir afin de réduire les effets sanitaires sur le bien-être de la population que pourraient causer ces vagues de chaleur et de réagir plus adéquatement lorsque ces aléas surviendront.
Consultez l'article et la carte interactive
Promouvoir la mobilité active
Claude Durocher et Guy Labrecque sont à l'origine du groupe Mobilité active ULaval. La raison d'être de Mobilité active ULaval est de créer une communauté de pratiques qui permettra de regrouper les membres de la communauté universitaire qui se transportent en tout ou en partie de façon active ainsi que les personnes qui passent de façon active par des lieux de notre université.
Les objectifs prioritaires sont de démontrer que se déplacer de façon active est le fun, facile et populaire, créer un lieu d’échanges sur le déplacement actif pour en faciliter la pratique et servir de canal de communication entre les adeptes du déplacement actif et les instances universitaires.
BMO et l’Université Laval s’unissent afin de créer un programme universitaire pour les jeunes leaders autochtones
15 novembre 2023
En partenariat avec l’Université Laval, BMO a annoncé aujourd’hui le lancement du programme BMO – Jeunes leaders autochtones, une initiative qui permet de soutenir les étudiantes et les étudiants en foresterie grâce à la remise de bourses, que ce soit pour des stages, la réalisation de projets spécifiques avec la communauté ou une expérience comme personne mentorée.
Dirigé par Jean-Michel Beaudoin, professeur au département des sciences du bois et de la forêt, et titulaire de la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, le programme procurera également aux étudiantes et aux étudiants en foresterie un meilleur accès à des ressources éducatives et à divers partenariats afin de les aider à réaliser des progrès professionnels et universitaires. Le programme sera rendu possible grâce à un don de 500 000 $ de BMO.
« Depuis plus de 30 ans, BMO a noué des relations solides et apporté un soutien constant à 270 communautés autochtones, a déclaré Grégoire Baillargeon, président, BMO, Québec. Le programme BMO – Jeunes leaders autochtones soutient le progrès de la relève entrepreneuriale autochtone tout en permettant le développement, l’accès à des ressources éducatives, à du mentorat et à la croissance d’un réseau d’affaires qui favorisent une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive. »
Des nouveaux horizons sans obstacle
En phase avec la raison d’être de BMO, qui est d’avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, le programme BMO – Jeunes leaders autochtones favorisera :
- l’éclosion du potentiel des étudiantes et des étudiants autochtones, offrant aux communautés autochtones un accès spécialisé à des experts forestiers hautement qualifiés;
- le développement d’une nouvelle génération de leaders autochtones;
- l’augmentation significative des possibilités pour les jeunes autochtones de progresser grâce à des occasions de carrière qui les mènent à la réussite dans les affaires et les aident au bout du compte à devenir des dirigeants prospères;
- l’amélioration des revenus et des conditions de vie des personnes, des familles et des communautés autochtones;
- la durabilité dans les pratiques forestières et la santé des écosystèmes forestiers qui sont au cœur des modes de vie des Autochtones;
- le développement du savoir-faire autochtone pour renforcer les capacités des organisations du secteur forestier à travailler sur des projets où la présence autochtone exige de nouvelles approches.
« BMO et l’Université Laval partagent la volonté de mettre en valeur la voix, la légitimité et les compétences des jeunes leaders issus des Premières Nations. Ce programme expérientiel distinctif renforcera le développement de compétences en foresterie et leur esprit entrepreneurial. Il favorisera également leur insertion professionnelle et les positionnera en tant qu’expertes et experts sur le territoire forestier », affirme la rectrice de l’Université Laval, Mme Sophie d’Amours.
BMO s’engage auprès des clients, des collègues et des collectivités autochtones en s’appuyant sur trois piliers – l’éducation, l’emploi et l’autonomisation économique – qui reposent sur une plateforme d’inclusion pour tous. Notre engagement à progresser vers une société inclusive sans obstacles et à soutenir le progrès socioéconomique des communautés autochtones comprend les éléments suivants :
- en septembre 2023, BMO lance le programme de prêt BMO pour les entrepreneurs autochtones, qui offre aux propriétaires d’entreprises autochtones un meilleur accès à des fonds de roulement, à des ressources éducatives et à des partenariats professionnels pour lancer, développer et accélérer leurs entreprises;
- pour soutenir les entreprises autochtones, BMO a augmenté le niveau d’achat de biens et de services auprès de partenaires autochtones – dépassant en 2022 son engagement de verser 10 millions de dollars par an auprès d’entreprises autochtones d’ici 2023;
- l’engagement de BMO à mobiliser 300 milliards de dollars en financement durable d’ici 2025 inclut des prêts aux entreprises et communautés autochtones dans la structuration du programme d’obligations durables de la Banque;
- pour avoir fait progresser les intérêts et le développement économique des Autochtones, BMO a reçu sept fois de suite la certification Or du programme de Relations progressistes avec les Autochtones (RPA). Ce programme est administré par le Conseil canadien pour l’entreprise autochtone (CCEA).
Pour en savoir plus sur l’engagement de BMO à soutenir les communautés autochtones, consultez le site www.bmo.engagements-autochtones.
Engagement de BMO envers les communautés autochtones
Depuis plus de trente ans, les Services bancaires aux Autochtones de BMO collaborent avec les communautés autochtones pour favoriser leur autodétermination économique. Par l’entremise d’un réseau de succursales et de bureaux de services bancaires aux entreprises situés à l’intérieur et à l’extérieur des réserves, BMO offre des produits et services financiers, y compris du financement pour le logement et la rénovation, des services de fiducie, des solutions de gestion de placements et du financement à long terme pour le développement des infrastructures et le développement économique dans les réserves. De plus, BMO a établi un partenariat avec l’Université des Premières Nations du Canada pour créer Nisitohtamowin – Une introduction à la compréhension des perspectives autochtones au Canada, un cours d’apprentissage en ligne mis gratuitement à la disposition de tous.
Pour plus d’informations sur la façon dont BMO travaille avec les communautés autochtones au Canada, cliquez ici ou visionnez le Rapport annuel sur les partenariats et les progrès en matière autochtone de BMO.
À propos de BMO Groupe financier
Fort d’actif total de 1 250 milliards de dollars au 31 juillet 2023, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d’employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d’affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d’être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s’engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société plus inclusive.
À propos de l’Université Laval
Facebook | Twitter | LinkedIn
Relations avec les médias :
Marie-Catherine Noël, Montréal, Mariecatherine.noel@bmo.com, 514-715-7327
Université Laval, Québec, medias@ulaval.ca, 418-656-3355
Source :
Relations publiques et protocole
Université Laval
418 656-3355
medias@ulaval.ca
Journée SIG Université Laval - 17 novembre!
12 novembre 2023
Soyez des nôtres pour cette 11e édition de la Journée SIG Université Laval qui aura lieu le vendredi 17 novembre dès 12 à la salle Le Cercle du Pavillon Desjardins. À l’image des éditions précédentes, l’événement propose encore une fois une variété d’activités ayant pour but de démystifier les données géospatiales et leurs applications.
Conférences
Cette édition propose trois conférences, dont une grand public présentée par Martin Coulombe de OSEDEA sur l'utilisation de robots Spot pour la collecte de données!
Concours cartographique
Admirez les projets cartographiques réalisés par des étudiantes et étudiants du Cégep Limoilou et de l’Université Laval et votez pour votre coup de cœur
Stations d’expérimentation
Plusieurs stations d’expériences géospatiales vous permettront de découvrir des technologies et des applications géospatiales fascinantes.
Capsules techno
Du 13 au 17 novembre, une courte capsule techno sera mise en ligne quotidiennement sur le site Web de l'événement.
Tous les détails à : Journée SIG Université Laval.
C'est un rendez-vous! Événement gratuit et ouvert à toutes et tous!
Concours cartographique La preuve par la carte
11 novembre 2023
Pour cette 7e édition du concours cartographique de la Journée SIG Université Laval, les étudiantes et étudiants de l’Université Laval aux trois cycles et du Cégep Limoilou sont invités à présenter leur plus belle carte réalisée durant leurs études, leur travail ou leurs projets personnels. Les cartes reçues seront affichées sur le site Web de l’événement è partir du jeudi 16 novembre 2023. Le public sera invité à voter pour son œuvre coup de cœur. Plusieurs prix seront remis aux participants.
Trois catégories sont proposées : « point de vue de cartographe », « point de vue d’artiste » et « carte dynamique (Web) ».
Les cartes, en format image numérique (avec lien Web dans le cas des cartes dynamiques), devront être reçues au plus tard le jeudi 16 novembre 2023 à midi, à cette adresse : journeesig@scg.ulaval.ca. Dans votre courriel, précisez les informations suivantes : votre nom, prénom, affiliation (ULaval ou Cégep Limoilou), programme d’études, le titre de la carte, la catégorie du concours, le contexte dans lequel elle a été réalisée et ce qu’elle permet d’analyser ou de mettre en lumière!
Tous les détails à : Concours La preuve par la carte.
Pour toute question : journeesig@scg.ulaval.ca
ASTM International honore Alexander Salenikovich avec son prix annuel le plus prestigieux
10 novembre 2023
ASTM International a décerné son prix annuel le plus éminent, le Prix du Mérite 2023, à Alexander Salenikovich pour ses contributions au comité du bois de l'ASTM.
Ce prix prestigieux, qui s'accompagne du titre de Fellow, représente la plus haute distinction de l'ASTM pour un service distingué et une participation exceptionnelle aux activités des comités internationaux de l'ASTM. Expert de premier plan dans la communauté de l'ingénierie du bois, M. Salenikovich a été reconnu pour son travail prolifique dans les codes et normes, ses recherches respectées et son dévouement à faire progresser les objectifs du comité.
Membre d'ASTM International depuis 2001, Alexander Salenikovich avait déjà été honoré par le comité avec le Prix de l'appréciation (2007) et le Prix du président sortant (2021).
Actuellement professeur en génie du bois au Département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval, où il travaille depuis 2003, il a obtenu son doctorat en foresterie et produits forestiers à la Virginia Polytechnic Institute and State University (Blacksburg, Virginie) en 2000.
À propos d'ASTM International
L'ASTM, en tant qu'organisme de normalisation, élabore et édite des normes techniques couvrant divers domaines tels que les matériaux, les produits, les systèmes et les services. Actuellement, ASTM International compte plus de douze mille normes répertoriées dans son catalogue. Ces normes jouent un rôle essentiel dans la fabrication et la commercialisation des produits, visant à garantir la fiabilité des produits et la sécurité des consommateurs, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel. Auparavant connu sous le nom d'American Society for Testing and Materials, cet organisme s'engage à promouvoir des normes de qualité pour soutenir la confiance des consommateurs.
Source : ASTM
Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté reçoit la Distinction Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière.
09 novembre 2023
L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec a décerné la Distinction Henri-Gustave-Joly-de-Lotbinière à Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval. Cette distinction est remise à une personne extérieure à la profession dont les actions auront fait progresser la cause forestière et contribué à l’avancement et au rayonnement de la profession.
Durant ses études supérieures, Nancy Gélinas a embrassé la foresterie avec une détermination qui n’a eu d’égale que sa persévérance. Quelques trente années plus tard, sa contribution au rayonnement de la foresterie et de la profession, à l’avancement de la cause forestière et son implication à différents niveaux dans plusieurs comités sont indéniables.
Premièrement, elle a marqué l’histoire de la foresterie en devenant la première femme doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique en plus de 110 ans d’histoire. Nancy Gélinas est professeure-chercheuse en économie forestière. Formée à l’Université Laval, dans trois facultés différentes, elle présente un parcours pluridisciplinaire alliant les mathématiques, l’économie et les sciences forestières. Arrivée à titre de professeure à l’Université Laval en 2004, elle avait amorcé sa carrière à l’Université de Moncton, campus d’Edmundston en 1997. Avant sa nomination à titre de doyenne, elle a été vice-doyenne aux études durant quatre ans. Les aspects sociaux, économiques et de gouvernance occupent une place importante dans ses projets de recherche, où la participation des acteurs dans un contexte multiressources domine. Elle a participé activement à la formation des futures ingénieures forestières et ingénieurs forestiers au fil du temps autant par l’enseignement en économie forestière, en foresterie internationale, en communication ou en marketing des produits forestiers. Elle a aussi supervisé plusieurs étudiantes et étudiants à la maîtrise et au doctorat.
Elle est constamment ouverte à animer différents colloques ou congrès en lien avec la foresterie. De plus, sa porte est toujours ouverte pour discuter avec la communauté étudiante de la Faculté ainsi qu’avec le personnel ou les gens du milieu. Que ça soit lors de la Semaine des sciences forestières, les 100 ans de l’OIFQ ou des colloques et congrès, elle contribue avec enthousiasme à différents événements.
Elle a également accepté de présider la Commission indépendante sur les caribous forestiers et montagnards. Un défi de taille sur un enjeu très controversé. Elle a relevé ce mandat avec toute son énergie, son professionnalisme et son intégrité. En 2015, elle a également co-présidé la consultation sur l’évaluation de l'impact social et économique de la mise en oeuvre des exigences du Forest Stewardship Council sur le territoire de la région du Saguenay – Lac-Saint-Jean. En 2022, elle a été co-organisatrice en chef du 5e Congrès mondial d’agroforesterie qui a eu lieu à Québec et qui a accueilli en présentiel et en virtuel près de 800 personnes de tous les continents. Elle a d’ailleurs remporté le concours de soutien à l’organisation de congrès internationaux qui visent à souligner des chercheurs et chercheuses qui s’investissent dans l’organisation de congrès scientifiques et qui génèrent des retombées économiques appréciables et qui contribue au rayonnement de la communauté.
Ces nombreuses contributions à la recherche en foresterie et sa participation à plusieurs publications dans le domaine de l’économie et la politique forestière sont également à souligner. Elle s’implique dans plusieurs comités ou associations et elle est notamment secrétaire-trésorière de la Société d’histoire forestière du Québec et membre du conseil d’administration du Centre d’enseignement et de recherche en foresterie (CERFO).
Cette distinction vient souligner sa grande contribution au rayonnement de la foresterie et de la profession d’ingénieures forestières et d’ingénieurs forestiers.

Lancement d’un nouveau livre sur l’expédition AKOR
08 novembre 2023
C’est le 7 novembre 2023 que s’est tenu le lancement du nouveau livre « 234 jours – La première traversée nord-sud du Canada ». Cet ouvrage est le récit de voyage de Guillaume Moreau, professeur au Département des sciences du bois et de la forêt et de son coéquipier Nicolas Roulx, qui ont tous deux traversé 7 600 kilomètres du nord au sud du Canada en canot, en ski et en vélo, et ce, dans des conditions souvent extrêmes.
Également capté par vidéo, ce périple a permis la production du documentaire « Canada Vertical » qui a été sélectionné comme finaliste au Banff Mountain Film Festival.
Découvrez le récit numérique de leur aventure produit par Radio-Canada
Résumé du livre
Échapper aux ours polaires et aux bœufs musqués, tolérer les blessures, survivre à l’isolement. Avancer… Continuer à avancer.
Les Québécois Nicolas Roulx et Guillaume Moreau ont traversé le Canada du nord au sud en canot, ski et vélo. 234 jours, près de 8 mois, c’est le temps qu’ils ont mis pour parcourir les 7 600 kilomètres, un exploit qui n’avait encore jamais été réalisé auparavant. 234 jours est le récit de cette expédition hors norme qui se lit comme un haletant roman d’aventures où l’on découvre que les pires obstacles ne sont pas ceux que l’on croit. Un périple qui se veut aussi une ode à l’immensité, à la beauté du territoire et à ceux et celles qui l’occupent depuis des millénaires.
Du ski de fond et de la raquette cet automne à la Forêt Montmorency
27 octobre 2023
L'Université Laval est heureuse d’annoncer que la pratique du ski de fond et de la raquette sera possible à la Forêt Montmorency dès la première neige, et ce, jusqu’au 31 décembre 2023.
Lors du forum public de la Forêt Montmorency, organisé par la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) en novembre dernier, certaines personnes présentes avaient exprimé le souhait d’une poursuite des activités de ski de fond sur ce territoire forestier. En réponse à ce désir, la FFGG s’était engagée à créer un comité de travail spécifiquement sur l’offre de ski de fond pour 2023-2024. Les travaux de préparation de la saison à venir ont été faits suite aux recommandations de ce comité.
Un troisième projet pilote se mettra donc en branle dans les prochaines semaines, soit dès que la neige sera en quantité suffisante. Ce projet permettra d’obtenir des informations importantes afin de définir un modèle d’affaires en vue d’une offre future d’activités récréotouristiques à la Forêt Montmorency. Une entente signée aujourd’hui octroi le mandat d’opération des pistes pour la pratique du ski de fond et de la raquette aux Services nordiques Bilodeau.
La doyenne de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique se réjouit de cette situation. « Nous avons entendu la population et respecté notre engagement de trouver une solution afin d’offrir à la population la possibilité de profiter d’une saison de ski précoce à la Forêt grâce à des conditions de neige habituellement exceptionnelles en début de saison. »
La Forêt Montmorency est une forêt d’enseignement et de recherche au sens de la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier, dont l’existence permet de favoriser l’enseignement pratique et la recherche appliquée en foresterie et en aménagement durable des forêts. Riche de son expérience de plus de 50 ans, faisant d’elle la plus vieille forêt d’enseignement et de recherche au Québec, la Forêt Montmorency constitue notamment le lieu de formation privilégié pour la relève en ingénierie forestière de l’Université Laval.
Source :
Relations publiques et protocole
Direction des communications
Université Laval
418 656-3355
medias@ulaval.ca
Crédit photo : Julie Moffet
Nouvelle Chaire de recherche en études indopacifique à l’Université Laval
05 octobre 2023
L’Université Laval et le ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec sont fiers d’annoncer la création de la Chaire de recherche en partenariat en études indopacifiques. Dans un contexte où l’Asie est devenue un pôle incontournable de la géopolitique et de la géoéconomie mondiale, son influence se fait sentir sur tous les grands enjeux planétaires. La mise en place de cette chaire est donc résolument d’actualité.
La direction de la Chaire est confiée au professeur titulaire du Département de géographie à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et directeur du Conseil québécois d’études géopolitiques, Frédéric Lasserre. Celui-ci a consacré principalement ses projets de recherche à la géopolitique et la géoéconomie en Asie. Il poursuivra ses travaux en ce sens en tant que titulaire de la Chaire en fédérant la recherche sur la région indopacifique dans une perspective pluridisciplinaire.
Le titulaire de la Chaire, Frédéric Lasserre explique que « la Chaire de recherche en partenariat en études indopacifiques facilitera, pour les géopolitologues, le développement d’une compréhension plus globale et plus large des questions relatives à la région indopacifique. La Chaire constituera un lieu de croisement, un carrefour des connaissances en la matière. Elle contribuera ainsi à mieux faire comprendre les enjeux géopolitiques asiatiques et leurs composantes extragéopolitiques à l’ensemble de la communauté d’expertes et d’experts du domaine et du grand public. »
Au cœur du Carrefour international Brian-Mulroney
Le Carrefour international Brian-Mulroney aspire à devenir le pôle d’excellence francophone en enseignement et en recherche pluridisciplinaires sur les défis internationaux. Ce projet permettra de répondre à des enjeux d’intérêt pour le Québec et le Canada. L’Université Laval, véritable université d’impact, contribuera ainsi de façon significative à accroître la place du Québec et de la francophonie canadienne à l’international. La création de cette chaire s’inscrit en ligne avec cet objectif.
« La création de la chaire de recherche répond directement à la volonté de l’Université Laval d’augmenter son impact international. Multiplier les alliances influentes et stratégiques comme nous le faisons aujourd’hui est la clé du succès. La nomination de Frédéric Lasserre à titre de titulaire de la Chaire de recherche en partenariat en études indopacifiques est un exemple renouvelé de l’intérêt et du dévouement du corps professoral de l’Université Laval pour la recherche consacrée aux enjeux globaux du monde contemporain », a souligné le vice-recteur adjoint aux services à la recherche, à la création et à l'innovation par intérim à l'Université Laval, Frédéric Picard.
L’engagement du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, partenaire incontournable et privilégié, à la hauteur de 1M$ pour les cinq ans d’activité prévus de la Chaire s’inscrit dans sa contribution majeure au projet de Carrefour international Brian-Mulroney à la hauteur de 27,75 M$.
« Le monde subi d’importants changements. De nouveaux centres géopolitiques émergent ce qui amène des occasions pour le Québec d’accroître et de diversifier ses liens à l’échelle internationale. Les travaux de cette chaire sauront assurément nous donner un éclairage fort instructif sur cette région », a déclaré la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron.
L’annonce publique de la Chaire s’inscrit dans la programmation du colloque Réalités plurielles de l’indopacifique qui se déroule les 5 et 6 octobre à l’Université Laval.
Source : Relations médias de l'Université Laval
Une première cohorte a terminé sa formation
30 septembre 2023
Un article d’ULaval nouvelles
Du 21 au 25 août, 24 personnes se sont réunies au Mushuau-nipi, un site ancestral autochtone situé sur la rivière George, au cœur de la toundra, à 250 kilomètres au nord-est de Schefferville. C’est en ce lieu hautement symbolique que 18 hommes et femmes issus des premiers peuples, la plupart des étudiantes et des étudiants innus, ont reçu leur certification de l’Université Laval après avoir suivi la nouvelle formation de gardien.nes de territoire pendant les sessions d’hiver et d’été 2023.
«À l’intérieur d’une grande tente traditionnelle innue, les participants se sont vu remettre un médaillon perlé confectionné par l’aînée Doris Bossum de Mashteuiatsh et une écharpe de graduation de l’Université Laval réalisée par Kanessa Michel, qui est étudiante en design graphique», explique la professeure du Département de géographie et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en patrimoine et tourisme autochtones, Caroline Desbiens. «On avait donc deux symboliques: l’autochtone et l’universitaire, poursuit-elle. La cérémonie voulait reconnaître l’effort des jeunes participants, leur persévérance. Ce fut vraiment un grand moment pour tous.»
Ce programme a vu le jour grâce au partenariat signé en 2022 entre l’Université et la Fondation Mastercard. Cette collaboration se traduit par une contribution financière de 15 millions de dollars étalée sur cinq ans.
«Le programme a suscité un grand intérêt, il y a eu un réel engouement, affirme la professeure. L’information a beaucoup circulé dans les réseaux sociaux autochtones. On avait de très bons candidats représentant une assez belle diversité, notamment quatre étudiants déjà inscrits à différents programmes d’études à l’Université Laval.»
Des personnes aînées et des femmes
La certification Gardien.nes de territoire vise à former des agents de protection autochtones aptes à intervenir sur les terres, les eaux et les ressources de leur territoire ancestral. Il s’agit du tout premier programme francophone du genre au Canada. Cette initiative de l’Université Laval a nécessité la collaboration étroite de personnes aînées autochtones du Québec et de représentants du réseau canadien des gardiens autochtones du territoire.
La formation comprenait trois blocs de cours donnés à distance par visioconférence entre l’hiver et l’été. Chacun des blocs était suivi d’un séjour en territoire. Les participants ont reçu notamment une introduction à l’éthique de la terre. Ils ont aussi acquis des savoirs pratiques pour la protection du territoire, comme la cartographie ou encore la surveillance environnementale. Le premier séjour s’est déroulé au mois de mars au site innu Kanapeut dans le Nitanissan de Pessamit, sur la Côte-Nord. Le deuxième a eu lieu en mai au camp Mistawak, dans le territoire des Abitibiwinni de Pikogan (Eeyou Istchee Baie-James). Le troisième et dernier séjour s’est passé au Mushuau-nipi, pour la cérémonie de graduation.
La cohorte comprenait un nombre presque égal d’hommes et de femmes, avec une légère majorité pour celles-ci. Diverses personnes aînées ont accompagné les apprenants lors des séjours en territoire, y compris en août dernier au Mushuau-nipi. Les formateurs autochtones, eux-mêmes gardiens de territoire ou leaders, ont été favorisés. Les professeures Caroline Desbiens et Allison Bain, celle-ci du Département des sciences historiques, ont également participé aux enseignements à distance et en territoire.
La professeure Desbiens insiste sur le fait que la formation accorde la priorité aux savoirs et expertises autochtones, dont ceux des personnes aînées et des femmes. «La place des femmes dans les sociétés autochtones est fondamentale, soutient-elle. C’est le respect de la vie, l’égalité et le respect de toutes les formes de savoirs. La formation reconnaît le travail des mains des femmes au même titre que celui des hommes pour le maintien de la santé des territoires.»
Selon elle, on a souvent tendance à privilégier les connaissances des chasseurs de gros gibier, «la grosse chasse», ainsi que la foresterie. «Or, poursuit-elle, les cultures autochtones conçoivent que tout est interdépendant. Il faut donc considérer ce qui est plus micro: les plantes, la confection des objets du quotidien. Souvent, ces choses sont passées sous silence, même si elles sont le liant de la vie sociale. Elles représentent un apport transversal à l’équilibre de la communauté.»
Durant les séjours en territoire, l’activité traditionnelle du perlage a été au centre des rencontres. Les protocoles de respect des animaux ont également été enseignés.
Une vision ambitieuse
«La vision derrière le programme est ambitieuse, souligne la professeure. Grâce aux gardiens de territoire, les communautés autochtones pourront renforcer l’ancrage à leur cultures respectives, elles pourront créer davantage d’aires protégées et de conservation autochtones. La transmission des savoirs ainsi que les partenariats avec la société allochtone s’en trouveront renforcés.»
La certification universitaire est une formation de perfectionnement qui permet à l’apprenant de contribuer à l’avancement de ses savoirs et de sa carrière. Elle conduit à l’obtention d’unités d’éducation continue. En cela, elle est différente du certificat, qui est un programme crédité de premier cycle totalisant 30 crédits.
«Nous avons choisi le modèle de la certification, car nous voulions deux choses: pas de barrières à l’admission pour les personnes autochtones et une formation courte très adaptable aux exigences, aux priorités et aux besoins de leur milieu», explique-t-elle.
À terme, un programme plus développé pourra donner accès à des crédits universitaires. Les professeurs de l’Université Laval seront de plus en plus appelés à participer à la formation. «Dès l’an prochain, poursuit-elle, le programme, qui est présentement coordonné par la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, sera appelé à s’élargir puisqu’il s’ouvrira à une nouvelle faculté. On prévoit y intégrer une nouvelle composante, l’archéologie. Le nom de la formation sera changé en celui de Gardien.nes du territoire afin d’adopter la terminologie du réseau canadien, qui a été lancé officiellement en décembre 2022.»
Les forêts québécoises en mal de diversification
29 septembre 2023
Les feux plus intenses et plus fréquents ne sont que l’un des nombreux périls qui menacent nos forêts, affectées par les changements climatiques et l’augmentation des échanges internationaux. Leur résilience passe par une nouvelle approche en aménagement.
Les gigantesques incendies qui ont ravagé différentes parties du Canada cet été ont marqué l’imaginaire. En date du 29 août, plus de 15 millions d’hectares de forêt ont brûlé, selon le Centre interservices des feux de forêt du Canada, une superficie plus grande que le Portugal et les Pays-Bas réunis. D’après le réseau World Weather Attribution, le réchauffement climatique a rendu sept fois plus probables les conditions météo extrêmes (températures élevées, faibles taux d’humidité) qui ont favorisé la propagation de ces incendies dans l’est du pays.
En règle générale, les forêts boréales se régénèrent assez bien après un feu. Cependant, les changements climatiques pourraient mettre cette capacité à l’épreuve en causant des brasiers plus intenses et surtout plus fréquents. « Prenons l’exemple d’une forêt boréale de l’Abitibi, qui subirait deux gros feux en 20 ans, dit Olivier Villemaire-Côté, professeur adjoint au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval. Les arbres qui ont commencé à pousser après le premier feu n’auront pas eu le temps d’arriver à leur maturité sexuelle, ce qui peut entraîner un échec de la régénération naturelle après le second feu. »
Les changements climatiques peuvent aussi augmenter la fréquence et l’intensité d’autres événements destructeurs pour les forêts, tels les grands vents et les épisodes de verglas. Par ailleurs, d’autres risques les menacent, notamment les insectes et les champignons. On a déjà vu les dommages que peuvent provoquer des insectes comme l’agrile du frêne, un coléoptère venu d’Asie, ou la maladie hollandaise de l’orme, causée par un champignon.
« On prévoit qu’entre 20 et 30 maladies ou espèces d’insectes pourraient remonter des États-Unis jusque chez nous dans les 30 prochaines années et menacer jusqu’à 40 % de nos essences d’arbre, prévient Christian Messier, professeur au Département des sciences biologiques de l’Université du Québec à Montréal. Donc, ce qu’on voit avec le frêne, l’orme et le hêtre n’est que le début. »
Comprendre la fonte du pergélisol pour s’y adapter
25 septembre 2023
Ce texte fait partie du cahier spécial Recherche: enjeux climatiques du journal Le Devoir
« Le nord du Canada s’est réchauffé et continuera de se réchauffer à un rythme plus de deux fois supérieur au rythme mondial », apprenions-nous en 2019 dans un rapport scientifique d’Environnement Canada. On peut de plus s’attendre à ce que de « grandes superficies » de pergélisol aient fondu d’ici 2050.
Dans le nord du pays, on ne se demande plus si les changements climatiques sont réels : ses effets sont visibles tous les jours, sur les infrastructures et les paysages. « On se demande surtout comment on va s’adapter », explique Pascale Roy-Léveillée, professeure au Département de géographie de l’Université Laval. La chercheuse s’est donnée pour mission de documenter cette nouvelle réalité pour permettre à ceux qui la subiront de mieux se préparer à l’avenir.
Paysage bouleversé
Le pergélisol, qui recouvre près de la moitié de la surface du Canada, contient notamment de grandes quantités de méthane, un puissant gaz à effet de serre, qui seront relâchées dans l’atmosphère en dégelant. Il soutient aussi les infrastructures du Nord, que ce soit les bâtiments ou les voies de transport, comme les routes et les chemins de fer. « Au tournant du XXe siècle, quand on a construit les voies ferroviaires, on croyait que le pergélisol était aussi solide que le roc », rappelle Pascale Roy-Léveillée.
Plus tout à fait. Déjà, la fonte de ce sol gelé mène à l’affaissement de certaines surfaces et bouleverse les paysages. La toundra, habituellement tapissée de mousses et de lichen, se recouvre lentement d’arbres et d’arbustes, enhardis par le dégel du sol qui leur permet d’y plonger des racines profondes. « Les gens s’enfargent dedans », constate la chercheuse. Cette nouvelle végétation devient aussi un obstacle pour les déplacements en motoneige.
Au-delà de la végétation, c’est tout le paysage qui se modifie, parfois abruptement. Un exemple concret : les lacs. « On peut voir que les lacs grandissent, ce qui est un phénomène tout à fait normal, mais qui est accéléré aujourd’hui », raconte celle qui est aussi titulaire de la Chaire de recherche en partenariat sur le pergélisol au Nunavik, dont les activités s’inscrivent dans le programme Sentinelle Nord. « Une fois trop plein, le lac va attraper une rivière ou un dénivelé et se videra subitement, en moins de 48 ou 72 heures. » Résultat : les locaux habitués de pêcher dans le plan d’eau arriveront, leur canne à la main, pour trouver une dépression asséchée.
Pour une population qui dépend de la chasse, de la pêche et de la cueillette pour la vaste majorité de son alimentation, un tel changement peut être désastreux.
Infrastructures instables
Les infrastructures locales souffrent aussi de la soudaine malléabilité du pergélisol. Pour prévenir les catastrophes, Pascale Roy-Léveillée et ses collègues sont allés mesurer les sols sur lesquels reposent les bâtiments des localités du Nunavik. Sont-ils composés de glace ou de roc ? La prochaine étape sera de décider quoi faire avec les bâtisses les plus à risque. « Au Nunavut, on prévoit des constructions sur pieux », indique la chercheuse, qui estime que ce type d’installation se multipliera au nord du 55e parallèle.
Des voies de transport essentielles, comme le chemin de fer de la baie d’Hudson, qui relie le nord et le sud du Manitoba, sont aussi menacées par le sol instable. Pascale Roy-Léveillée participe justement à un projet, en collaboration avec des géomorphologues, des géocryologues et des ingénieurs, qui permettra de documenter le pergélisol tout au long des rails et de dresser un portrait des risques actuels et futurs.
Soutenir l’adaptation
« Nous, dans le Sud, on se demande souvent quels sont les effets du réchauffement sur les infrastructures dans le Nord, parce que nous sommes une population urbaine qui vit dans un milieu très bâti, relève Pascale Roy-Léveillée. Mais dans le Nord, la proportion du paysage bâti est très faible. »
Bien consciente de ses biais, la chercheuse préfère demander aux communautés du Nord quels sont leurs besoins pour décider de ses prochains sujets d’étude, plutôt que de se fier à son instinct. Quelles sont leurs préoccupations, leurs questions ? « On ne peut pas s’adapter à un risque qu’on ne comprend pas bien », résume-t-elle. Selon les demandes, elle documentera les niveaux de mercure dans les sols de la plaine d’Old Crow, connue localement comme Van Tat, au Yukon, ou le risque de glissement de terrain à Salluit, dans le Nunavik.
« Parfois, les nouvelles sont meilleures que prévu, se réjouit la professeure. C’est important de donner les bonnes nouvelles quand il y en a. Ça permet de réduire l’anxiété des gens du Nord qui font face à ces changements sur leur territoire. Parce que leur territoire, c’est eux. »
Québec verse 425 000 $ à l’Université Laval pour appuyer la réalisation de l’Atlas du Québec
21 septembre 2023
Le gouvernement du Québec annonce l’octroi d’une aide financière de 425 000 $ à l’Université Laval pour soutenir la réalisation de l’Atlas du Québec.
L’annonce a été faite par Mme Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, en présence de Mme Pauline Marois, première ministre du Québec de 2012 à 2014, et de Mme Sophie D’Amours, rectrice de l’Université Laval.
Dirigé par les géographes Yves Brousseau et Guy Mercier, professeurs titulaires au Département de géographie, l’Atlas du Québec sera un ouvrage de référence d’intérêt général cherchant à illustrer et à expliquer les différentes facettes de la réalité québécoise. Cet atlas portant exclusivement sur le Québec considérera l’entièreté du territoire québécois et couvrira environ 200 thèmes de la géographie du Québec.
Sous-titré « Expliquer le Québec en l’illustrant », l’atlas fera connaître le Québec par la cartographie en présentant, à travers une série de cartes commentées, une connaissance générale du territoire québécois, de ses régions, de ses écosystèmes, de sa population et des activités qui l’animent. Chacune des cartes traitera d’un aspect particulier de la réalité québécoise, autant sur les traits permanents de la géographie du Québec, que sur ses transformations historiques et ses évolutions plus récentes.
La production de l’Atlas du Québec implique un investissement de 850 000 $ sur trois ans, dont la moitié provient de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval et l’autre moitié du gouvernement du Québec. Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts verse 225 000 $ tandis que le ministère de la Culture et des Communications contribue à la hauteur de 200 000 $.
« À titre de ministre responsable d’établir et de gérer la cartographie et les réseaux géodésiques officiels du Québec, je suis très fière d’appuyer le projet d’Atlas du territoire québécois et de savoir que son élaboration repose notamment sur les sources de données de référence du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Cet atlas brossera un portrait exhaustif de la géographie du Québec. Bravo! », a souligné Mme Blanchette Vézina.
Une parution prévue pour 2025
L’Atlas du Québec sera disponible en format papier d’environ 250 pages et en format numérique. Sa publication est prévue au printemps 2025, de sorte que les données tirées du recensement canadien de 2021 y seront intégrées. Il sera mis à jour périodiquement pour assurer sa pérennité.
Selon les instigateurs du projet Yves Brousseau et Guy Mercier, « L’Atlas du Québec comblera un vide, puisqu’aucun ouvrage de ce type n’a été publié depuis les années 1970. Nous pensons qu’une société mature a besoin d’un livre comme le nôtre pour se comprendre et partager ces savoirs à l’international. Le financement gouvernemental représente pour nous l’aboutissement de plusieurs années de réflexion. »
L’Atlas du Québec est produit au sein du Laboratoire de cartographie de l’Université Laval, qui est reconnu pour son expertise depuis plusieurs années. Il assure, depuis 1963, la production de cartes et de graphiques de haute qualité destinés à l’enseignement et à la recherche scientifique ainsi qu’au grand public.
L'annonce publique du financement est disponible en réécoute.
Visionner
Un nouveau documentaire souligne les travaux d’une équipe de recherche en géographie
02 septembre 2023
Les Premiers Hommes de Saint-Pierre-et-Miquelon : un film documentaire de Xavier Fréquant, qui met en lumière les travaux des chercheuses et chercheurs et des étudiantes et étudiants en géographie et en archéologie de l’Université Laval, qui inclue entre autres, une intervention de la professeure Najat Bhiry.
En collaboration avec leurs collègues français, ils ont réussi à démystifier la présence paléo-inuite et amérindienne sur un archipel français, situé en Amérique du Nord. L’odyssée de ces peuples est racontée avec finesse, doigté et passion dans un cadre naturel époustouflant.
Réalisation : Xavier Fréquant
Production : Wapiti Production, avec la participation de France Télévisions
Durée : 55 min
Nos chercheuses et chercheurs reçoivent plus de 1,2M$ en subventions de recherche par le CRSNG et le CSRH
01 septembre 2023
Félicitations à six chercheuses et chercheurs de la FFGG, qui reçoivent un financement totalisant 1,2 millions de dollars du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) et du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) pour leurs projets de recherche!
CRSNG - Découverte
- Mathieu Bouchard reçoit 160 000$ pour son projet « Prise en compte des changements climatiques dans la planification forestière à long terme », en plus d’un montant de 12 500$ grâce au supplément Tremplin vers la découverte.
- Sylvie Daniel reçoit 210 000$ pour son projet « Innovative deep learning solutions leveraging unlabeled and multi-source annotated datasets to segment and monitor change in large scale 3D point clouds for digital twin cities. »
- Mir Abolfazl Mostafavi reçoit 210 000$ pour son projet « Leveraging senseable cities for inclusive mobility : dynamic routing in disruptive sidewalks. »
- Stéphane Roche reçoit 158 500$ pour le projet « Intelligence des environnements urbains anthropocènes – IAU. »
CRSNG – Outils et instruments de recherche
- Alain Cloutier reçoit 143 994$ pour un instrument d’analyse thermique d’adhésifs et de revêtements de haute performance pour l’industrie du bois.
CRSH - Savoir
- Danièle Bélanger reçoit 359 685$ pour le projet « The new face of migration management in Canada : digitalisation, automation and AI. »
De nouvelles infrastructures innovantes en recherche à la FFGG
01 septembre 2023
Bravo aux professeures et professeurs Janani Sivarajah, Ilga Porth, Louis Bernier, Pascale Roy-Léveillée, Émilie Saulnier-Talbot et Dermot Antoniades, ainsi que leurs équipes respectives, qui sont récipiendaires de financement qui contribuera à l'avancement de la recherche!
Les professeures Janani Sivarajah et Ilga Porth, et le professeur Louis Bernier, de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, reçoivent un financement de 291 388 $ pour la création du Laboratoire d'adaptation et de résilience au climat des forêts urbaines. Premier du genre dans un climat nordique comme celui de Québec, ce laboratoire facilitera les collaborations à l’échelle locale et nationale. Les équipements de pointe permettront de créer des systèmes socioécologiques urbains adaptatifs, résilients et fonctionnels, et de développer des outils de gestion des arbres et des sols urbains. « Il s'agit d'une occasion unique de faire progresser les connaissances en matière de foresterie urbaine, à un moment où la recherche et les ressources sont nécessaires pour lutter contre les conséquences des changements climatiques », souligne Janani Sivarajah.
L’équipe de Pascale Roy-Léveillée, professeure à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, se voit octroyer 186 614 $ pour étudier les dynamiques géomorphologiques des plaines pergélisolées en dégradation et les rétroactions environnementales. La moitié du Canada comporte des zones pergélisolées et leur dégel présente des risques pour les infrastructures nordiques et accélère les changements environnementaux dans les territoires où les communautés chassent et pêchent. Les fonds serviront à l'achat d'un système aéroporté d’acquisition d’images géoréférencées combiné à un module amélioré d’imagerie souterraine pour l’étude des substrats pergélisolés. « Le financement permettra de développer une approche polyvalente et moderne pour cartographier la vulnérabilité au dégel du pergélisol dans les milieux construits et naturels, entre autres pour faciliter la gestion d'une infrastructure vitale pour les collectivités et l'industrie du Nord », souligne Pascale Roy-Léveillée.
La professeure Émilie Saulnier-Talbot et le professeur Dermot Antoniades, de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, reçoivent 174 426 $ pour le déploiement d’une infrastructure de chromatographie liquide de haute performance. L’appareil permettra d’analyser les pigments algaux et bactériens dans l’eau et ses sédiments pour déterminer la présence et l’abondance de différents groupes, comme les cyanobactéries. Une meilleure compréhension de la dynamique temporelle et spatiale guidera les gestionnaires dans la conservation des ressources aquatiques. « Grâce à cette subvention, nos équipes seront en mesure de mieux comprendre la nature et l’ampleur des changements s’opérant dans les écosystèmes aquatiques canadiens dans le contexte des bouleversements climatiques actuels », indique Émilie Saulnier-Talbot.
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique félicite ces équipes, qui contribuent activement à l’avancement des connaissances et au rayonnement de la recherche!
Source : Près de 7 M$ pour l’ajout d’infrastructures innovantes en recherche à l’Université Laval (ulaval.ca)
Départ à la retraite du professeur Louis Bernier
31 août 2023
Louis Bernier prend une retraite bien méritée après plus de 32 années à occuper le poste de professeur à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique! S’étant joint au Département des sciences du bois et de la forêt comme professeur adjoint le 31 décembre 1990, Louis a développé une expertise en champignons, pathologie forestière, santé des forêts et mycologie, sujets qu’il enseignait avec passion.
Professeur Bernier est détenteur d’un baccalauréat en génie forestier de l’Université Laval, d’une maîtrise en sciences forestières et d’un doctorat en pathologie forestière de l’Université de Toronto, ainsi que de deux postdoctorats en biologie moléculaire des champignons et en génétique microbienne de l’Université Laval.
Séduit par le « côté obscur » des champignons, il s’est penché dans sa carrière sur des espèces particulières qui ont décimé des populations d’ormes en Europe et en Amérique du Nord. Ses découvertes lui ont permis d’approfondir les rudiments de la génétique des champignons. Il a ensuite mis l’expertise développée à profit en mettant en place au sein du Département des sciences du bois et de la forêt un programme de recherche en pathologie forestière qui fait une place de plus en plus importante aux différents outils de la génomique.
« Louis Bernier est un passionné de la course à pied sur le campus, mais aussi de sa recherche en laboratoire. De la maladie hollandaise de l’orme qui était son cheval de bataille pour préserver nos ormes au Québec et en Amérique du Nord, il a diversifié sa recherche pour s’intéresser aussi aux champignons bénéfiques des plantes comme la culture in vitro des champignons mycorhiziennes arbusculaires et la culture des champignons ectomycorhiziens comestibles. Sa carrière en tant que chercheur et formateur a couvert les champignons ennemis et amis de plantes. Je garde un souvenir d’un bon collègue avec un sourire aux lèvres chaque fois qu’on se rencontre. » – Damase P. Khasa, professeur
« Louis Bernier est l'expert par excellence de la maladie hollandaise de l'orme et d'autres maladies vasculaires des arbres. Nous collaborons depuis 2016 dans le cadre d'un projet financé par Génome Canada sur la biosurveillance des ravageurs et des pathogènes envahissant les forêts, et ses connaissances et surtout son enthousiasme ont été une source d'inspiration non seulement pour ses étudiants et ses postdocs, mais aussi pour moi. J'ai le plaisir de continuer à collaborer avec Louis dans le cadre d'un projet nouvellement financé, ce qui n'a pu se faire que grâce à ses connaissances exceptionnelles sur le système d'étude. » - Ilga Porth, professeure
Nous tenons à remercier le professeur Bernier pour toutes ses années de collaboration au sein de notre Faculté et pour la relève qu’il a maintes fois inspirée à poursuivre dans le domaine de la mycologie et de la pathologie forestière.
Nous lui souhaitons une longue retraite riche en nouvelles expériences!
Départ à la retraite de la professeure Alison Munson
31 août 2023
C’est après 32 années de service comme professeure en aménagement écosystémique des forêts, écologie de la restauration et de l’ensauvagement et biologie forestière au Département des sciences du bois et de la forêt qu’Alison Munson prend sa retraite et quitte la grande famille FFGG le 1er septembre.
D’origine ontarienne, Alison est titulaire d’un baccalauréat en agriculture, d’un diplôme professionnel en classification écologique d’Agriculture Canada, à Guelph, d’un doctorat en biochimie des forêts, ainsi que d’un postdoctorat en biogéochimie des plantations. Experte dans les domaines de la biogéochimie forestière, de l’écologie de la restauration, Mme Munson est cotitulaire de la Chaire de recherche sur l’arbre urbain et son milieu et y gère le volet portant sur l’identification des facteurs qui influencent la survie des nouvelles plantations en milieu urbain.
«Lorsque j'ai commencé à assumer mes nouvelles fonctions de professeure adjointe et de titulaire de la chaire sur l'arbre urbain et son milieu au plein de la pandémie, la présence calme d'Alison Munson et son rôle de mentor m'ont été très utiles. Bien que je la connaisse depuis moins de deux ans, elle a été une collègue formidable qui m'a montré comment naviguer dans mon nouveau rôle. J’admire sa passion pour la recherche et l'enseignement, ainsi que sa capacité, en tant que femme scientifique, à surmonter les difficultés au cours de sa carrière universitaire.» - Janani Sivarajah, professeure
« Alison a toujours su poser un regard éclairé sur les grandes questions environnementales, démontrant une ouverture particulière pour les approches interdisciplinaires et même holistiques. Comme nouveau professeur à la faculté, elle m’a accueilli très chaleureusement dans un esprit de camaraderie et de collégialité qui représente si bien notre faculté. Je l’ai vu agir en tant que leader positive et généreuse qui sait faire bénéficier de ses acquis à l’ensemble de la collectivité. » - Jean-François Bissonnette, professeur
« Alison a été une professeure déterminée avec un grand respect pour les personnes. Elle a débuté ses recherches postdoctorales à l’Université Laval alors j’étais étudiante au doctorat avec le même directeur, M. Hank Margolis, dans le domaine de l’écophysiologie forestière. De Chibougamau à Petawawa (Ontario), et même ailleurs, Alison mettait une grande confiance auprès de tous ceux avec qui elle œuvrait. Elle a inspiré de nombreux étudiants du monde entier et maîtrisait l’art de la rédaction scientifique. Ce fut un plaisir de la connaître et de travailler en collaboration avec elle toutes ces années. » - Marie R. Coyea, responsable de travaux pratiques et de recherche en écophysiologie
Nous tenons à exprimer notre gratitude à la professeure Munson pour toutes ces années de collaboration et de dévouement à l'enseignement et à la recherche dans le domaine des sciences du bois et de la forêt au sein de notre faculté. Nous lui souhaitons une bonne santé et de longues années de retraite auprès de sa famille et de ses proches.
Marie-Hélène Vandersmissen nommée vice-doyenne aux études
23 août 2023
Marie-Hélène Vandersmissen, professeure titulaire et directrice du Département de géographie de 2015 à juin 2023, occupe la fonction de vice-doyenne aux études depuis le 22 août 2023. Elle succède ainsi au professeur Yves Brousseau, qui occupait le poste depuis les 2 dernières années et demie. Nancy Gélinas, doyenne de la Faculté, a tenu à souligner l’implication et le travail de M. Brousseau, qui a débuté ses nouvelles fonctions en plein cœur d’une pandémie qui a entraîné un lot de défis inattendus qu’il a su relever avec brio.
Selon Mme Gélinas, « Mme Vandersmissen était la personne tout indiquée pour prendre la relève comme vice-doyenne. En plus de l’expérience de gestionnaire acquise à titre de directrice de département et de sa connaissance des processus entourant la gestion des études, elle possède des qualités humaines essentielles. Sensible et attentionnée, désirant offrir le meilleur service et la plus grande qualité d’enseignement à la communauté étudiante, nul doute qu’elle saura bien accompagner l’équipe de la gestion des études dans sa mission ».
Marie-Hélène Vandersmissen a complété son baccalauréat ainsi que sa maîtrise en géographie à l’Université de Sherbrooke. Après avoir obtenu son doctorat en aménagement du territoire et développement régional à l’Université Laval en 2000, elle a poursuivi ses recherches postdoctorales à l’INRS-Urbanisation, Culture et Société, avant de se joindre comme professeure au Département de géographie de l’Université Laval, en 2002. Elle a alors développé ses expertises de recherche et d’enseignement autour du milieu urbain, du transport urbain ainsi qu’en méthodes quantitatives et en analyse spatiale. Elle a de plus occupé le poste de rédactrice en chef de la revue Les Cahiers de géographie du Québec.
Nous lui souhaitons le meilleur succès dans ses nouvelles fonctions!
Fonte des glaces: «on est capable de relever ces défis»
28 juillet 2023
Le 21 juillet dernier, Pascale Roy-Léveillée s'est jointe à l'émission radio "C'est encore mieux mieux l'après-midi" pour discuter de la fonte des glaces au nord du Québec.
Écoutez le segment disponible en ligne.
Les glaces des régions au nord du Québec fondent. Parmi les températures records partout dans le monde ce mois-ci, le thermomètre indiquait 34,1°C le 4 juillet à Kuujjuaq, qui était l'endroit le plus chaud au pays.
La professeure agrégée Pascale Roy-Léveillée se spécialise dans les vulnérabilités des terrains au dégel, et elle rappelle que les communautés nordiques, souvent autochtones, doivent s'adapter dès maintenant aux augmentations de température. Selon elle, des investissements sont nécessaires pour aider les populations à s'adapter aux changements climatiques. Ces dernières ont des conséquences importantes comme des glissements de terrain, ainsi que des impacts directs sur la culture de la chasse et de la pêche. « On est capable de relever ces défis, mais il faut s'y mettre », soutient Mme Roy-Léveillée.
Source: Radio-Canada
Félicitations à Stéphane Roche, nouveau directeur de l’Institut en environnement, développement et société
13 juillet 2023
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique tient à féliciter Stéphane Roche, professeur au Département des sciences géomatique et collaborateur hors pair, pour sa nomination à titre de directeur de l’IEDS. Son expertise et sa mobilisation pour la recherche font de lui la meilleure personne pour poursuivre la mission de l’IEDS et faire rayonner ses activités.
La nomination de Stéphane Roche a été approuvée par le Comité exécutif de l’Université Laval le 29 juin dernier. M. Roche est professeur au Département des sciences géomatiques de la Faculté de foresterie, géographie et de géomatique (FFGG). Il a été directeur du Département de sciences géomatiques de 2007 à 2011, vice-doyen aux études et à la recherche de la FFGG de 2014 à 2018 et directeur de la recherche et des affaires académiques à l’Institut national de la recherche scientifique de 2018 à 2020. Au cours de l’année universitaire 2022-2023, il fut professeur invité et responsable du pôle d’études et de recherche sur les environnements urbains à l’Université de l’Ontario français.
Membre chercheur de l’Institut EDS depuis 2005, il succède à Sehl Mellouli, qui occupait le poste de directeur depuis janvier 2023. Le professeur Sehl Mellouli est également vice-recteur adjoint aux études et aux affaires étudiantes de l'Université Laval.
Sur l’Institut EDS
L’Institut EDS, à titre de carrefour scientifique interdisciplinaire, offre une vitrine privilégiée de collaboration et un apport concret de la recherche à nos communautés pour une actualisation du développement durable et des Objectifs de développement durable de l’ONU. Il accompagne ses membres et chacune de ses parties prenantes en ce sens.
Source : ULaval nouvelles
Nouvelle aide financière de 600 000 $ pour soutenir la recherche sur le pergélisol au Nunavik
06 juillet 2023
La sécurité et la qualité de vie dans les villages nordiques du Nunavik sont importantes pour le gouvernement du Québec. C'est pourquoi le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce l'octroi d'une aide financière additionnelle maximale de 600 000 $ sur deux ans à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l'Université Laval. Ainsi, cette dernière pourra continuer de soutenir la Chaire de recherche en partenariat sur le pergélisol au Nunavik et les travaux qu'elle mène.
Le réchauffement climatique provoquant le dégel du pergélisol, la sécurité et la résilience des communautés du Nunavik sont déjà affectées par des dommages subis par les bâtiments et les infrastructures. La qualité de vie des personnes est également touchée en raison d'un accès restreint au territoire pour la pratique d'activités traditionnelles de chasse, de pêche et de cueillette. Les chercheurs travaillent donc en collaboration avec les communautés du Nunavik, afin que les savoirs locaux et scientifiques leur permettent de s'adapter aux impacts du réchauffement climatique sur le pergélisol. La Chaire de recherche souhaite également augmenter la résilience des communautés nordiques face aux changements environnementaux.
Ce nouvel appui du gouvernement du Québec fait suite à une aide de 900 000 $ accordée en 2021 pour la création de la Chaire de recherche et son fonctionnement pendant les trois premières années. Les sommes accordées serviront à :
- Maintenir et développer les connaissances sur le pergélisol et sa sensibilité au dégel, dans un contexte de changements climatiques;
- Soutenir et accélérer l'adaptation aux changements climatiques des régions pergélisolées du Québec, en collaboration avec les communautés;
- Assurer la pérennité de la Chaire de recherche.
Citations :
« Les communautés du Nunavik voient leur environnement se modifier rapidement en raison des changements climatiques. La poursuite des activités de la Chaire de recherche contribuera à assurer le maintien et le développement à long terme des connaissances, d'une expertise et d'une capacité de recherche sur le pergélisol à l'Université Laval. C'est essentiel pour accélérer la mise en œuvre de solutions d'adaptation aux impacts des changements climatiques dans cette région. »
Benoit Charete, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides
« Les impacts des changements climatiques au Nunavik sont parmi les plus rapides dans toutes les régions du monde. Il est essentiel de s'assurer que ces derniers puissent être freinés rapidement. Avec l'annonce d'aujourd'hui, nous croyons que le travail ne peut que s'accélérer. Grâce au savoir ancestral des Inuit et aux chercheurs de l'Université Laval, j'ai espoir que des solutions concrètes seront trouvées afin que nous puissions préserver ce vaste territoire. »
Ian Lafrenière, ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit
« Les travaux ont eu des retombées tangibles sur la résilience des infrastructures et la planification durable des villages. Je salue ce nouveau soutien gouvernemental grâce auquel la Chaire de recherche pourra poursuivre l'excellent travail réalisé jusqu'à présent, en partenariat avec les communautés locales et les organisations régionales. »
Denis Lamothe, député d'Ungava
« Le financement annoncé aujourd'hui témoigne à la fois de l'expertise de l'Université Laval en matière de recherche sur le pergélisol et de la relation de confiance établie depuis de nombreuses années entre nos scientifiques et les populations du Nunavik. L'Université Laval est heureuse de pouvoir poursuivre cette collaboration sur un enjeu d'une importance cruciale pour le développement durable des communautés du Nord. »
Sophie D'Amours, rectrice de l'Université Laval
Faits saillants :
- L'aide financière découle de l'action 3.5.1.1 du plan de mise en œuvre du Plan pour une économie verte 2030, qui vise à poursuivre l'acquisition de connaissances sur le dégel du pergélisol.
- Les activités de la Chaire de recherche s'inscrivent également dans le cadre du programme Sentinelle Nord de l'Université Laval.
Liens connexes
- Plan pour une économie verte 2030
- Chaire de recherche en partenariat sur le pergélisol au Nunavik
- Sentinelle Nord
Source :
Mélina Jalbert
Attachée de presse
Cabinet du ministre
de l'Environnement, de la Lutte
contre les changements climatiques,
de la Faune et des Parcs et ministre responsable
de la région des Laurentides
Tél. : 418 803-2351
Information :
Relations avec les médias
Ministère de l'Environnement,
de la Lutte contre les changements climatiques,
Faune et des Parcs
Tél. : 418 521-3991
Équipe des relations publiques et du protocole
Université Laval
418 656-3355
medias@ulaval.ca
crédit photo: Antoine Boisson
Comprendre la dynamique des avalanches dans le Grand Nord canadien pour mieux s’y préparer
27 juin 2023
Une équipe de chercheurs de l’Université Laval a découvert les conditions météorologiques favorables au déclenchement des avalanches. Elle espère ainsi améliorer leur prédiction et éviter des tragédies.
Dans la nuit du 31 décembre 1998, des membres de la communauté de Kangiqsualujjuaq réunis dans le gymnase d’une école pour les festivités du Nouvel An ont été frappés par une avalanche. Elle avait fait 9 morts et plus de 25 blessés.
« Cette tragédie indiquait clairement une lacune dans les connaissances associées à la dynamique des avalanches au Nunavik », souligne dans un communiqué de presse Jérémy Grenier, diplômé de la maîtrise en sciences géographiques à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique.
Dans l’étude publiée dans la revue Arctic, Antarctic, and Alpine Research, les scientifiques ont voulu répondre à cette lacune en s’intéressant au cas de la vallée Tasiapik, traversée par la seule route donnant accès au lac Tasiujaq depuis le village d’Umiujaq. Elle explique que le contexte actuel des changements climatiques crée davantage de redoux hivernaux qui perturbent les régimes de précipitations.
Lancement d'un nouveau "bac à sable" à réalité augmentée
20 juin 2023
C’est le 20 juin que s’est tenu le lancement officiel du nouveau « bac à sable » cinétique à réalité augmentée. Fruit d’une collaboration entre le Département des sciences géomatiques, la Bibliothèque et de la Direction de la philanthropie et des relations avec les diplômées et diplômés, ce nouvel outil est accessible à tous dans le secteur du Centre GéoStat au 4e étage de la Bibliothèque et se veut une façon d’introduire nos étudiantes et étudiants à la visualisation topographique en réalité augmentée.
Le «bac à sable» offre la possibilité de comprendre le territoire, notamment des concepts géographiques, géologiques et hydrologiques. En façonnant le sable, on peut modeler un modèle topographique augmenté en temps réel par l’affichage d’un dégradé de couleurs d’élévation et de courbes de niveau, qui se réajustent automatiquement en fonction du modelage. Il permettra d’enrichir l‘expérience des usagères et usagers, de renforcer l’appui à l’enseignement et à l’apprentissage et de favoriser la collaboration avec le milieu de la recherche.
Un fonctionnement à la fine pointe
Le «bac à sable» à réalité augmentée se compose d’une table de sable cinétique, d’un senseur, d’un projecteur et d’un ordinateur. Le senseur détecte la hauteur et l’emplacement du sable dans le bassin pour transmettre cette information à l’ordinateur. Ce dernier calcule la projection appropriée et transmet les informations au projecteur, qui diffuse ensuite en temps réel les lignes topographiques et les couleurs sur le sable.
Là où sont plantées les perches
12 juin 2023
Trois partenaires lancent conjointement une carte narrative sur une expédition de canotage et de portage jusqu’à un site sacré dans le territoire de la communauté de Uashat mak Mani-Utenam, sur la Côte-Nord.
Kuakushuakanashkuat ka tshimashuht. En langue innue, ce nom signifie «Là où sont plantées les perches». Il désigne un site patrimonial et sacré pour le peuple innu, un symbole identitaire situé à environ 150 kilomètres au nord de Sept-Îles, au cœur de l’arrière-pays de la Côte-Nord. C’est aussi le titre d’une fort belle carte narrative récente fruit d’un partenariat entre Innu Takuaikan Uashat mak Mani-Utenam, la Chaire de recherche du Canada en patrimoine et tourisme autochtones, et la Bibliothèque de l’Université Laval.
Cette carte est le récit d’une expédition de 10 jours effectuée à l’été 2020 par 7 personnes. Leur objectif: refaire en canot et à pied, en pagayant sur les rivières et en cheminant à l’intérieur des terres, une partie du parcours effectué par des générations d’Innus d’hier à aujourd’hui, depuis la région de Sept-Îles jusqu’aux territoires de chasse beaucoup plus au nord. L’expédition avait comme destination le lac Matinipi. La partie sud de ce lac est considérée patrimoniale et sacrée par les Innus de par la présence, encore aujourd’hui, de nombreuses perches d’épinette blanche enfoncées dans le lit vaseux du lac et visibles sous la surface des eaux. Pendant des siècles, les Innus ont utilisé ces perches pour propulser leurs canots lorsqu’ils remontaient les rivières à contre-courant vers les territoires de chasse. Une fois au lac Matinipi, le changement de direction du courant faisait en sorte qu’ils n’avaient plus besoin des perches pour continuer leur voyage. Ils les plantaient là.
La Chaire sur l'arbre urbain et son milieu offre plusieurs projets de maîtrises, un doctorat et un postdoctorat!
06 juin 2023
La Chaire de recherche sur l’arbre urbain et son milieu (CRAUM) est à la recherche d’étudiantes et d'étudiants pour de nouveaux projets à la maîtrise, au doctorat et même au postdoctorat sous la direction de Sivajanani Sivarajah. Joignez une équipe dynamique qui a à coeur l’inclusion, l’entraide et l’ouverture d’esprit ! Si vous vous intéressez aux impacts de la construction sur les arbres urbains, les sols urbains, les changements climatiques ou tout ce qui a trait à la foresterie urbaine et la recherche, ces offres sont pour vous, jetez-y un coup d’oeil !
Maîtrise en sciences forestières avec mémoire
- Évaluez les habitats de croissance et l'utilisation historique des terres et leurs effets sur les arbres urbains dans différents quartiers de la ville de Québec
- Évaluez les impacts des grands travaux de construction sur les réponses écophysiologiques des arbres urbains de la ville de Québec
- Analyser le potentiel, développer et réaliser des sols construits (technosols) en zone urbaine
Doctorat en sciences forestières
Postdoctorat
Cliquez sur chaque offre de projet pour voir tous les détails, le financement et les objectifs de recherche.
Pour information:
Sivajanani Sivarajah
Professeure adjointe
Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
sivajanani.sivarajah@sbf.ulaval.ca
Najat Bhiry, nouvelle directrice du Département de géographie
05 juin 2023
Nous sommes heureux d’annoncer la nomination de la professeure Najat Bhiry à titre de directrice du Département de géographie de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. Mme Bhiry est entrée en fonction le 1er juin 2023 pour un mandat de 4 ans. Elle succède à Mme Marie-Hèlène Vandersmissen qui occupait ce poste depuis le 1er juin 2015.
Madame Bhiry se spécialise dans la géologie du Quaternaire et géomorphologie (stratigraphie, sédimentologie, micromorphologie), les aléas et risques naturels, la paléoécologie végétale, ainsi que la géoarchéologie et les paléoenvironnements.
Merci à Mme Marie-Hélène Vandersmissen pour le travail accompli à la direction du Département de géographie au cours des 8 dernières années et bienvenue à Mme Najat Bhiry dans ses nouvelles fonctions.
Dévoilement des récipiendaires des Prix Enseignement et Encadrement de la FFGG
05 juin 2023
La Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique remet une fois l’an les Prix Enseignement et Encadrement. C’est sur recommandation des étudiants et sous la responsabilité d’un comité dont font partie les étudiants que sont nommés les récipiendaires des Prix Enseignement et Encadrement de la FFGG. De plus, afin de favoriser un plus grand nombre et de faciliter l’analyse et la comparaison des candidatures, les trois prix sont offerts en rotation au sein des trois départements de la FFGG; un prix par département, par année.
Prix «Enseignement - corps professoral» - Évelyne Thiffault
Le prix «Enseignement - corps professoral» vise à reconnaître publiquement l’excellence de l'enseignement d'une professeure ou d'un professeur à la Faculté. Pour le concours 2023, le prix est remis à un membre du corps professoral du Département des sciences du bois et de la forêt. Le prix est remis à Évelyne Thiffault - Pour ses nombreuses qualités, dont la sensibilité, l’écoute, le dévouement et la grande disponibilité, de même que son habileté à favoriser les échanges, à entrer en contact avec ses étudiants et étudiantes et à transmettre sa passion, parce que cet engagement et cette bienveillance se réalisent dans l’excellence, la rigueur et l’innovation.
Prix «Enseignement - autre personnel enseignant» - Jean-Philippe Veilleux
Le prix «Enseignement - autre personnel enseignant» vise à reconnaître publiquement l’excellence de l'enseignement de la part du personnel enseignant non membre du corps professoral, tel que les responsables de travaux pratiques, responsables de formation pratique, chargé(e)s d’enseignement, chargé(e)s de cours et professionnel(le)s responsables d’un ou plusieurs cours à la Faculté. Dans le cadre du concours 2023, le prix est remis à un membre du personnel enseignant non membre du corps professoral du Département des sciences géomatiques. Le récipiendaire est Jean-Philippe Veilleux - Grandement estimé des étudiants et étudiantes pour son professionnalisme et sa connaissance du domaine, de même que ses qualités personnelles : son accessibilité, son habileté à mettre en confiance, son énergie et sa passion.
Prix «Encadrement» - Pascale Roy-Léveillée
Le prix «Encadrement» vise à reconnaître publiquement l’excellence de l'encadrement aux cycles supérieurs d'une professeure ou d'un professeur de la Faculté. Pour le concours 2023, le prix est accordé parmi le corps professoral du Département de géographie. Le prix est remis à Pascale Roy-Léveillée - Professeure disponible, bienveillante, les étudiants et étudiantes reconnaissent et apprécient sa rigueur, son accompagnement vers le développement de l’autonomie, la rapidité de ses retours très constructifs et les moyens innovants déployés pour offrir le meilleur encadrement qui soit. Pour sa passion et son énergie dans sa recherche qui rejaillissent inévitablement sur la qualité de son encadrement et que son équipe étudiante apprécie grandement.
Félicitations aux trois récipiendaires!
Lisa Tischenko étudiante au doctorat en sciences forestières finaliste du concours La preuve par l'image
11 mai 2023
Lisa Tischenko, une étudiante de la Faculté au doctorat en sciences forestières sous la direction d'Ilga Porth est finaliste au concours La preuve par l'image pour sa photo intitulée "La chaîne du chêne".
Voici la description de son image: Semblables à des méduses, des bouts d’ADN du chêne rouge baignent dans ces tubes. Cette molécule sous forme de chaîne, l’ADN, contient l'information génétique chez tous les êtres vivants, à plumes, à poils ou à feuilles. D'un individu à un autre, l’information varie au sein d’une espèce selon les conditions de leur milieu. L’analyse de ces échantillons servira à répertorier les variations génétiques au sein des populations de chênes rouges du nord-est de l’Amérique. Dans un contexte de changements climatiques, on pourra ainsi sélectionner des semences adaptées, favorables à une gestion durable de nos forêts. (Taille des échantillons d’ADN: entre 5 et 8 mm | Photographie numérique)
Les responsables des concours de photographie scientifique La preuve par l'image et Science Exposed viennent de divulguer les oeuvres finalistes pour 2023. Rappelons que ces concours sont organisés par l'Acfas et par le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada dans le but de célébrer l'image comme moyen de communication scientifique dans tous les domaines de la connaissance. Les organisateurs récompenseront les trois œuvres les plus remarquables parmi les 20 images finalistes de chaque concours. De plus, un prix du public sera décerné à l'œuvre qui aura recueilli le plus de votes d'ici le 17 septembre à chacun de ces concours.
Sources:
Lancement d’une nouvelle carte interactive de la vulnérabilité de la population canadienne aux vagues de chaleur accablante
02 mai 2023
Une équipe de recherche du Département de géographie de l’Université Laval lance aujourd’hui une toute première carte interactive de la vulnérabilité et de l’exposition de la population canadienne aux vagues de chaleur accablante. Sous forme de cartographie Web, cet outil facile d’utilisation est disponible dès maintenant tant pour le grand public que pour les professionnels et les décideurs dans le domaine de l’aménagement, de l’urbanisme et de la santé publique.
En raison des changements climatiques, la fréquence et l’intensité des vagues de chaleur augmentent au Canada. Cette menace accentue la pression sur la santé de la population puisque la chaleur accablante tue plus de personnes chaque année au pays que tout autre événement météorologique.
Or, la vulnérabilité et l’exposition de la population aux vagues de chaleur varient dans le temps comme dans l’espace, ce qui fait en sorte que certains groupes sont plus à risque. Pour évaluer la variabilité géographique, l’équipe de recherche a fait appel à plusieurs types de données (socio-économiques, démographiques, accessibilité géographique à certains services, caractéristiques de l’environnement bâti) afin de calculer quatre indices distincts associés à la vulnérabilité et à l’exposition aux vagues de chaleur :
Indice de sensibilité
L’indice de sensibilité regroupe plusieurs informations démographiques et socio-économiques qui peuvent influencer l’intensité avec laquelle les vagues de chaleur accablante sont ressenties (âge des habitants, types de ménage, caractéristiques des logements, etc.)
Indice de capacité à faire face
L’indice de capacité à faire face tient compte de la proximité de différents lieux et de services où il est possible de se réfugier lors d’une vague de chaleur accablante (centres commerciaux, parcs, piscines publiques, etc.)
Indice d’exposition
L’indice d’exposition est calculé à partir de renseignements principalement obtenus par imagerie satellitaire portant notamment sur la température et l’imperméabilité du sol, la végétation, le cadre bâti, la proximité de l’eau et l’altitude.
Indice de vulnérabilité
L’indice de vulnérabilité a été créé en combinant les résultats des indices de sensibilité et de capacité à faire face : le résultat de l’indice de la capacité à faire face (facteurs qui rendent la population moins vulnérable) a été soustrait de celui de l’indice de sensibilité (facteurs qui rendent la population plus vulnérables).
Ces différents indices ont été intégrés au sein d’une application de cartographie Web qui permet d’observer en un coup d’œil la distribution géographique de la vulnérabilité et de l’exposition aux vagues de chaleur accablante dans les zones habitées de 156 régions métropolitaines et agglomérations canadiennes. Les différents indices ont été calculés à l’échelle de l’aire de diffusion, soit la plus petite région géographique normalisée pour laquelle toutes les données du recensement canadien sont diffusées et qui regroupe généralement de 400 à 700 citoyens.
« Les autorités locales, régionales et provinciales ont à faire face aux conséquences sanitaires, sociales et économiques engendrées par les changements climatiques. Grâce à l’information mise à leur disposition par le biais de notre cartographie interactive, elles seront en mesure d’intervenir afin de réduire les effets sanitaires sur le bien-être de la population que pourraient causer ces vagues de chaleur et de réagir plus adéquatement lorsque ces aléas surviendront », explique Nathalie Barrette, professeure au Département de géographie de l’Université Laval et co-chercheuse du projet.
Ce projet a été rendu possible grâce à la contribution des personnes suivantes, toutes du Département de géographie de l’Université Laval : Yves Brousseau, chercheur principal et professeur; Marie-Hélène Vandersmissen et Nathalie Barrette, professeures; Benoit Lalonde, Jean-Philippe Gilbert, Marie-Janick Robitaille et Karine Tessier, professionnels; Mathilde Giguère, Janis Lapointe, Stéphanie Piché et Jérémi Juteau, étudiants à la maîtrise.
Le projet a été financé par la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) dans le cadre du programme Défi d’offre de logement.
Source :
Équipe des affaires publiques et du protocole
Université Laval
418 656-3355
medias@ulaval.ca
En complément, consultez le contenu publié à ce sujet dans La Presse + (édition du mercredi 3 mai 2022)
Immigration : le Québec fracasse un record
20 avril 2023
Le Québec a fracassé un record en immigration au cours des derniers mois. En 2022, le nombre d'immigrants dans la province a augmenté de près de 150 000. C'est la plus forte hausse annuelle de son histoire. Une hausse attribuable en grande partie à l'augmentation du nombre de résidents non permanents.
Pour analyser ces données, entrevue avec Adèle Garnier, professeure agrégée et directrice des programmes de 1er cycle en géographie à l'Université Laval.
La campagne de la communauté universitaire 2023 est officiellement lancée!
17 avril 2023
Du 17 avril au 2 juin, manifestez votre générosité envers notre université!
Reconnue sur la scène mondiale, l’Université Laval se démarque par la vitalité de son offre pédagogique, le caractère multidisciplinaire de sa communauté d’enseignement et de recherche et la sophistication de ses infrastructures. De Québec à l’international, notre université donne des ailes aux talents d’ici et d’ailleurs.
En soutenant la Campagne Communauté ULaval, vous prenez part à l’attribution de milliers de bourses d’études, encouragez le développement de projets d’enseignement audacieux et participez à l’optimisation de nos programmes sportifs, de nos collections d’ouvrages et de nos laboratoires.
Unissons nos forces et ensemble, allons bien plus loin pour notre université.
Donnez à l’un des 32 fonds de la FFGG
Fonds généraux facultaires
- Fonds de bourses Persévérance de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (6155)
- Fonds d’enseignement et de recherche de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (0906)
- Fonds de bourses de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (0615)
- FIE de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (0062)
- Fonds d’initiatives FFGG – formation, recherche et développement (0657)
Fonds en foresterie
- Fonds de la Forêt Montmorency (9064)
- Fonds de bourses des diplômés en génie et en sciences du bois (6157)
- Fonds de la Bourse foresterie sans frontières (6158)
- Fonds J.-André-Fortin (6153)
- Fonds de recherche et de développement en foresterie – Fonds de bourses Jean-Claude et Lisette-Mercier (2321)
- Fonds Pierre-Richard-et-Dominique-Saunier: recherche, formation et développement à la Forêt Montmorency (0641)
- Fonds de recherche et de développement en foresterie (0232)
- Fonds de bourse-stage en région de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (6161)
- Fonds Famille Gilbert-Tardif visant l’excellence de la recherche pour les produits et la construction en bois (6160)
- Fonds Produits forestiers D & G (6159)
- Fonds de bourses Thérèse Sicard – Belle Audace – 6163
- Fonds Nathalie Pratte en environnement – 6573
Fonds en géographie
- Fonds de bourses d’excellence en géographie – 1er cycle (6156)
- Fonds de bourses Fernand-Grenier en géographie humaine (6154)
- Fonds de bourses en géographie (6151)
- Fonds du Laboratoire vivant des Petites franciscaines de Marie (6571)
Fonds en géomatique
- Fonds de bourse Ted-T.-Katz, ing., a.-g. et Robert-Katz, ing., a.-g. en sciences géomatiques (6152)
- Fonds Joncas (0613)
- Fonds de soutien pour la relève en génie géomatique (6572)
Fonds de Chaires de recherche
- Fonds de soutien à la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone (8061)
- Fonds de soutien à la Chaire de leadership en enseignement sur la politique appliquée à la forêt privée (8063)
- Fonds de soutien à la Chaire de leadership en enseignement en construction intégrée en bois (8062)
Autres fonds
- Fonds d’héritage de Géoïde (0486)
- Fonds de contribution au financement du Centre de recherche sur les matériaux renouvelables (0339)
- Fonds Produits forestiers Résolu en aménagement durable des forêts (0225)
- Fonds Kruger (bourses) (0048)
- Fonds FPInnovations d’appui à la formation et la recherche à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique de l’Université Laval (0637)
La candidature d’Anticosti pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO
17 avril 2023
Paru dans la plus récente édition de la revue Le Naturaliste canadien, qui porte entièrement sur la recherche à Anticosti, ce nouvel article signé Pascale Marcotte, professeure titulaire au Département de géographie de l’Université Laval, en collaboration avec André Desrochers, professeur auxiliaire à l’Université d’Ottawa et Katie Gagnon, consultante et coordonnatrice à la concertation pour la candidature d’Anticosti au patrimoine mondial de l’UNESCO, fait état du projet d’inscription de d’Anticosti sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Crédit photo : Le Naturaliste canadien
Deux étudiantes au certificat en tourisme durable se démarquent lors du Gala de la relève en tourisme.
14 avril 2023
Frédérik Ducas, étudiante au certificat en tourisme durable est lauréate dans la catégorie Certificat-Études Universitaires du Comité sectoriel de main d’œuvre en tourisme remis lors du Gala de la relève en tourisme de l’Association québécoise de la formation en restauration, tourisme et hôtellerie (AQFORTH). Elle a aussi été finaliste pour le prix Coup de cœur universitaire de la Fondation Alliance pour la relève! Frédérik s’intéresse particulièrement à la mise en valeur de nos régions par le tourisme. Elle croit que l’avenir de notre territoire et de nos communautés passe par la reconnexion avec la Terre mais aussi la reconnexion entre nous.
Découvrez la vidéo de mise en candidature de Frédérik Ducas.
Soulignons aussi sa collègue Alexandra Gosselin, également étudiante au certificat en tourisme qui était finaliste dans la même catégorie. Elle a d’ailleurs un parcours des plus intéressants avec un DEP en restauration, un baccalauréat en géographie et un certificat en tourisme. Elle commencera aussi une maîtrise en sciences géographiques avec comme thème de recherche la mise en valeur des ressources naturelles et du patrimoine comme produit touristique.
Découvrez la vidéo de mise en candidature d’Alexandra Gosselin.
Félicitations à nos étudiantes au certificat en tourisme durable!
Les changements climatiques peuvent-ils aussi affecter le cours des rivières ?
13 avril 2023
Pascale Roy-Léveillée, professeure de géographie et spécialiste en pergélisol, explique les conséquences de la fonte du pergélisol sur les rivières de l'Arctique à l'émission Moteur de recherche sur ICI radio-Canada.
Écoutez l'entrevue diffusée mercredi le 12 avril 2023 à 19 h 36.
Conflit pour l'accès à l'eau aux États-Unis
13 avril 2023
Le professeur de géographie et directeur du Conseil québécois d'Études géopolitiques, Frédéric Lasserre, explique le conflit entre plusieurs états américains qui se disputent le fleuve Colorado à l'émission L'heure du monde sur ICI Radio-Canada.
Écouter l'entrevue diffusée mardi le 11 avril 2023, 18 h 36 (Nouvelle mesure potentielle pour protéger la rivière Colorado).
Des étudiantes et des étudiants du cégep Ste-Foy découvrent nos domaines d'études par des ateliers pratiques et des visites de laboratoires.
11 avril 2023
Les étudiantes et les étudiants de 1ère année en sciences de la nature du cégep Ste-Foy sont venus explorer le 11 avril dernier nos différents domaines d'études et de carrière dans le cadre de leur Journée périscolaire. Ils ont pu manipuler différents outils de la géomatique, visiter les laboratoires en génie du bois, essayer des instruments de mesure des arbres comme la sonde de Pressler, faire un atelier de granulométrie dans la laboratoire de sédimentologie, découvrir la dendrochronologie et les différents inventaires du milieu naturel. C'était aussi une occasion d'en apprendre plus sur les possibilités de carrière en génie forestier, environnement, génie du bois, géographie, génie géomatique et arpentage.
La thématique principale intitulée "L’ingénierie et l’innovation au service de l’environnement, de la forêt, du bâtiment durable et du géospatial!" comportait trois ateliers distincts:
- Des applications concrètes en conservation des milieux naturels et en changements climatiques
- L’ingénierie et l’innovation au coeur de la forêt et de la construction en bois
- Découvrez le génie géomatique, l'arpentage et le monde géospatial!




L’Université Laval inaugure son Cercle des Premiers Peuples
06 avril 2023
L'Université Laval et l'équipe du secteur Premiers Peuples sont très fières d'inaugurer le Cercle des Premiers Peuples. Cet espace de sécurisation culturelle, destiné a priori à la communauté autochtone du campus, est également un point de rencontre et d'échange avec les allochtones de toute la communauté universitaire.
En collaboration avec un comité d'étudiantes et d'étudiants et l'équipe du secteur Premiers Peuples, tout a été mis en œuvre pour concrétiser cet espace qui se veut un endroit respectueux des cultures et valeurs de chacun. Situé à la Bibliothèque du pavillon Jean-Charles Bonenfant, ce lieu assure une diversité de services et d'activités adaptés aux besoins spécifiques des étudiantes et étudiants, tels que la reconnaissance culturelle, l'intégration à Québec, l'aide aux devoirs, le soutien psychologique, la recherche de bourses ou d'hébergement et le soutien administratif.
«La création du Cercle des Premiers Peuples, un espace de sécurisation culturelle à l'Université Laval, est un exemple d'une action concrète pour favoriser la réussite des étudiants autochtones. Je suis confiant que d'autres initiatives similaires verront le jour ailleurs, dans d'autres institutions. Je tiens à saluer l'ouverture et le leadership de l'Université Laval dans ce projet», souligne le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière.
Deux personnes issues des Premières Nations, Suzie Perron et Yves Sioui, ont leur bureau à même le Cercle et agissent à titre de conseillers aux étudiantes et étudiants pour assurer un soutien constant et un accompagnement personnalisé. La valorisation des cultures autochtones par la création de différentes activités thématiques est un autre objectif identifié par l'équipe. Repas, conférences, travaux, discussions et ateliers d'artisanat en sont quelques exemples.
«La création du Cercle des Premiers Peuples était un des engagements de l'Université Laval lorsqu'elle a déposé le plan En action avec les Premiers Peuples en décembre 2020, rappelle la rectrice de l'Université Laval, Sophie D'Amours. L'objectif était de créer un lieu culturellement sécuritaire favorisant la réussite des étudiantes et des étudiants issus des Premiers Peuples qui poursuivent leur cheminement à l'Université Laval. C'est une autre belle réalisation qui s'inscrit dans notre volonté de contribuer à un véritable processus de réconciliation.»
Dans une ambiance chaleureuse proposant des éléments des différentes nations, les personnes de la communauté autochtone auront l'occasion de se ressourcer, de partager leur propre vision du monde et de faire rayonner leur culture. L'accès au local est possible 7 jours sur 7.
«L'Université met en place des outils pour soutenir sa communauté étudiante dans son cheminement et sa réussite. Le Cercle en est un voué à créer un environnement propice à l'épanouissement des étudiantes et étudiants des Premiers Peuples dans leur portage académique», souligne Michèle Audette, conseillère principale à la réconciliation et à l'éducation autochtone de l'Université Laval.
Chaque année à l'Université Laval, environ 400 étudiantes et étudiants s'autodéclarent comme étant des Premières Nations ou des Inuit, ce qui classe l'établissement d'enseignement au premier rang de la province à ce chapitre.
Source: ULaval nouvelles
Grâce à ses partenaires, la Faculté remet plus de 423 000 $ en bourses à 95 étudiantes et étudiants
30 mars 2023
C’est le mardi 28 mars 2023 qu’avait lieu la cérémonie des bourses et des prix de la Faculté. La doyenne, Mme Nancy Gélinas, a souligné le mérite de 95 étudiantes et étudiants de la Faculté qui sont repartis avec plus de 423 000 $ en bourses durant la soirée.
La doyenne a tenu à remercier tous les partenaires de la Faculté grâce à qui ces bourses ont pu être accordées. Les dons et les fonds créés par les donatrices et donateurs permettent d’encourager l’excellence et l’engagement des étudiantes et étudiants aux trois cycles d’études et favorisent grandement leur persévérance. La doyenne a vivement salué l’arrivée de nouveaux donateurs et donatrices, qui contribuent à des bourses en sciences du bois et de la forêt, en sciences géomatiques et en géographie.
Au cours de la cérémonie, trois finissantes de premier cycle ont aussi reçu le prix Rayonnement de la Faculté pour leur participation remarquable à la vie étudiante, leur engagement dans leur futur milieu professionnel ou leur contribution significative à la promotion de leur domaine d’études auprès des jeunes ou du grand public. Les récipiendaires de chacun des trois départements de la Faculté sont :
- Mme Lysianne Desgagné-Etcheverry, en géographie;
- Mme Monica Gagnier, en sciences du bois et de la forêt;
- Mme Catherine Gionet-Pichette, en sciences géomatiques.
De plus, M. Jean-Philippe Veilleux, responsable de travaux pratiques et de recherche, a reçu le prix «Enseignement - autre personnel enseignant» qui vise à reconnaître publiquement l’excellence de l'enseignement de la part du personnel enseignant non membre du corps professoral de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. C’est sur recommandation des étudiantes et étudiants, et sous la responsabilité d’un comité dont font partie des membres étudiants de chacune des associations étudiantes de la Faculté que sont nommés les récipiendaires des Prix Enseignement et Encadrement de la Faculté.
La cérémonie a permis à tous, étudiants, étudiantes, membre du personnel, partenaires et amis de la FFGG de constater l’importance de contribuer aux différents fonds et projets de la Faculté. Riche d’une tradition plus que centenaire et de programmes uniques au Québec, la Faculté possède tous les atouts pour développer une grande culture philanthropique.

Félicitations aux participantes et participants du concours facultaire Ma thèse en 180 secondes
20 mars 2023
Le 14 mars dernier se tenait le concours facultaire Ma thèse en 180 secondes, de retour en format présentiel dans la cafétéria du pavillon Abitibi-Price. Nous tenons à féliciter l’ensemble des participantes et participants qui se sont prêtés au jeu, car cela prend beaucoup de courage et de préparation pour relever un tel défi!
Merci aussi à celles et ceux qui ont contribué à l’organisation de l’événement. Un merci tout particulier à notre animateur, M. Alexis Achim, ainsi qu’à nos trois juges : Ann Delwaide, David Pothier et Francis Roy. Enfin, merci au public enthousiaste qui est venu encourager nos participantes et participants en très grand nombre! Nous vous remercions chaleureusement pour votre engagement dans la vie facultaire!
Voici les récipiendaires des prix de 180 $ du concours 2023 :
- 1er Prix volet anglophone – Bourse CRMR : Vahideh Akbari – Michael-addition : A new born superhero in Wood densification. Vahideh est étudiante au doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés sous la direction de Véronic Landry.
- 1er Prix volet francophone – Bourse CEF : Maxime Parot - Transformation du bois en fibres de carbone. Maxime est étudiant au doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés sous la direction de Tatjana Stevanovic.
- Prix coup de cœur du public no 1– Bourse CRDIG : Abdessamad Jiloul – inspirons-nous du carton pour construire notre future maison. Abdessamad est étudiant au doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés sous la direction de Pierre Blanchet.
- Prix coup de cœur du public no 2– Bourse FFGG : Vahideh Akbari – Michael-addition : A new born superhero in Wood densification. Vahideh est étudiante au doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés sous la direction de Véronic Landry.
Vahideh représentera la FFGG lors de la finale institutionnelle UL, volet anglophone, du concours Ma thèse en 180 secondes en vue de représenter l’Université Laval à la finale de l’Est du Canada.
Maxime représentera la FFGG lors de la finale institutionnelle UL, volet francophone, en vue de participer au concours « Ma thèse en 180 secondes » de l’ACFAS.
Nous vous invitons à les encourager en suivant la webdiffusion de la finale ULaval (en français et en anglais) le 22 mars 2023 à 12 h sur la chaîne Youtube de la FESP.
Votre Comité organisateur MT180s FFGG édition 2023 :
Emmanuelle Rousseau et Shawn Lajoie – Semaine des sciences forestières
Marta Alonso Garcia – Centre d’étude de la forêt
Besma Bouslimi – Centre de recherche sur les matériaux renouvelables
Sonia Rivest – Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Sauphie Senneville – Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
La migration des rivières nordiques avec les changements climatiques défie les prédictions
13 mars 2023
Une équipe de recherche internationale a été surprise de constater que les rivières nordiques ne se déplacent pas comme les modèles prédictifs l'annonçaient en fonction du réchauffement de la région.
Une équipe de recherche internationale a été surprise de constater que les rivières nordiques ne se déplacent pas comme les modèles prédictifs l'annonçaient en fonction du réchauffement de la région. Elle a fait cette observation alors qu'elle surveillait l'impact des changements climatiques sur les grands fleuves de l'Arctique canadien et de l'Alaska.
Avec le dégel du pergélisol, de nombreux scientifiques ont prédit que la migration des rivières nordiques pourrait entre autres être accélérée avec la déstabilisation et l'érosion des berges. Cette hypothèse dominante n'avait jamais été vérifiée jusqu'à présent par rapport aux mesures de migration des rivières à méandres dans les zones de pergélisol.
L'équipe, dont fait partie la professeure agrégée au Département de géographie de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Pascale Roy-Léveillée, a analysé une collection d'images satellites prises à intervalles réguliers, certaines datant de plus de 50 ans. Ils ont comparé plus d'un millier de kilomètres de berges de dix rivières arctiques de l'Alaska, du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest.
Un guide pour découvrir la grandeur des petites plantes
23 février 2023
L'ouvrage grand public À la découverte des mousses et autres bryophytes ouvre une porte sur l'univers fascinant de ces plantes lilliputiennes
Bonnet d'elfe, or des lutins, gnome discret, ébouriffe triangulaire, tricot à feuilles longues, arabesque des forêts, grand éteignoir… Si ces noms ne vous disent rien, c'est que, comme la grande majorité des gens, vous ne connaissez pas les plantes appartenant au groupe des bryophytes. Et pourtant, elles se retrouvent dans tous les milieux et vous en avez probablement piétiné sans vous en rendre compte. Grâce aux efforts d'une équipe de passionnés, coordonnés par la technicienne experte du Département des sciences du bois et de la forêt de l'Université Laval, Martine Lapointe, l'univers fascinant de ces plantes lilliputiennes vous est maintenant accessible.
Les bryophytes, dont le groupe le plus connu sont les mousses, sont des espèces de taille réduite, beaucoup moins colorées que les plantes à fleurs, ce qui explique en partie pourquoi elles ne suscitent pas spontanément l'intérêt. «Ce sont les parents pauvres de la botanique, constate Martine Lapointe. C'est pour faire connaître ces espèces au plus grand nombre qu'un groupe de botanistes membres de la Société québécoise de bryologie a eu l'idée de produire un premier guide vulgarisé sur les bryophytes du Québec.»
L'idée a germé il y a un peu plus de 10 ans alors que Jean Faubert, qui était alors président de cette société, préparait son ouvrage scientifique La flore des bryophytes du Québec-Labrador. «C'est lui qui nous a allumés sur les bryophytes et qui nous a transmis sa passion, rappelle Martine Lapointe. Il souhaitait qu'un guide grand public sur ces plantes soit publié un jour. Malheureusement, il est décédé en 2018. C'est pourquoi le guide lui est dédié.»
Carte narrative d’une excursion au site sacré des Perches
21 février 2023
En août 2020, de jeunes innus se sont rendus au site sacré des Perches. Pour ce voyage, ils ont accueilli trois chercheur.e.s du département de géographie de l’Université Laval (Caroline Desbiens, Justine Gagnon et Jimmy Couillard-Després). Un carnet de voyage relatant cette expédition a été mis en ligne.
KUAKUSHUAKANASHKUAT KA TSHAMMISHIHT : CARTE NARRATIVE D’UNE EXCURSION AU SITE DES PERCHES
Le territoire ancestral de Uashat mak Mani-Utenam regorge de lieux exceptionnels. L’un de ces endroits est Kuakushuakanashkuat ka tshamishiht – « Là où sont plantées les perches » – au sud du lac Matinipi. Des générations d’Innus ont laissé des traces de leur passage dans ce site où sont plantées plusieurs perches utilisées pour la remontée des rivières.
Discrètes mais bien tangibles sous les eaux, ces perches sont encore visibles aujourd’hui et sont devenues un symbole identitaire. Une nouvelle génération veut voir ces témoins du passage de leurs ancêtres sur le territoire. Les jeunes Innus reprennent le chemin vers Kukushuakanashkuat ka tshimishiht pour connaître leur histoire, leur territoire et aussi pour le protéger.
Découvrez la carte narrative
Écoutez l'entrevue de Radio-Canada sur le sujet
INFORMATION
Yoan Jérome (yoan.jerome.1@ulaval.ca)
Yasmine Fontaine (yasmine.fontaine.1@ulaval.ca)
Posez votre candidature aux Prix Chisholm de l’innovation en foresterie
20 février 2023
Organisés par l’Association des produits forestiers du Canada, les Prix Chisholm de l'innovation en foresterie sont remis aux lauréats d’un concours national destiné aux jeunes chercheuses et chercheurs qui se passionnent pour un éventail d'activités liées à la science forestière, aux produits utilisant des matières premières de la forêt, à l'amélioration des procédés ou à d'autres innovations le long de la chaîne de valeur du secteur forestier.
Ces prix ne visent pas seulement à récompenser la recherche et le développement, mais aussi à mettre en valeur le travail de la relève étudiante et en recherche qui s’intéressent à la foresterie et aux produits forestiers respectueux du climat, à la fabrication propre et à la bioéconomie forestière.
Les récipiendaires seront célébrés le 8 mai 2023, recevront un prix en espèces de 2 500 dollars canadiens et bénéficieront d'une promotion médiatique locale, régionale et nationale.
Les personnes posant leur candidature doivent être des étudiantes ou étudiants ou des chercheuses ou chercheurs âgés de 30 ans ou moins au 7 avril 2023. Ils doivent mener des projets de recherche et d'innovation dans le domaine de la foresterie, des produits forestiers et/ou des technologies de transformation des produits forestiers - avec des liens avec des universités, des centres de recherche publics ou privés et/ou des départements de recherche et d'innovation d'entreprises.
Thème 2023 : Promouvoir la décarbonisation dans le secteur des produits forestiers grâce à l’innovation dans la chaîne de valeur.
« Allez vers l'étudiant étranger, qu'il soit Noir, Français, Arabe… On a besoin d'amour! »
20 février 2023
Ils viennent du Congo, du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire et d'Haïti. Ils étudient, font de la recherche ou enseignent à l'Université Laval. Cinq membres de la communauté noire ont été réunis par la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique (FFGG) pour partager leur histoire, le 16 février, à midi. Des parcours remplis de rêves, de persévérance, mais aussi jalonnés de défis, dont celui de s'intégrer quand on est loin des siens. D'où cet appel du cœur de Sena Pricette Dovonou-Vinagbe: «Allez vers l'étudiant étranger, qu'il soit Noir, Français, Arabe… On a besoin d'amour!»
Des avalanches de sédiments; Patrick Lajeunesse à l’émission Découverte
06 février 2023
Le dimanche 5 février dernier, Patrick Lajeunesse, professeur au Département de géographie de l’Université Laval, et Alexandre Normandeau, chercheur en géosciences marines à la Commission géologique du Canada, ont eu l’occasion d’expliquer le phénomène des avalanches de sédiments créés dans les canyons sous-marins du Saint-Laurent lors d’un segment de l’émission Découverte, de Radio-Canada.
À propos de la recherche
[…] Alexandre Normandeau, chercheur en géosciences marines à la Commission géologique du Canada, et Patrick Lajeunesse, professeur au Département de géographie de l’Université Laval, ont cartographié depuis 2019 ces canyons de long en large grâce, entre autres, à un robot sous-marin.
« C'est un drone, ni plus ni moins. Il enregistre les données de positionnement, mais prend aussi des mesures de profondeur et des différentes caractéristiques du fond marin. »
— Une citation de Patrick Lajeunesse est professeur au Département de géographie à l’Université Laval
Au fil des ans et des relevés, ils ont observé des déplacements de dépôts massifs de sédiments au fond de ces canyons.
Ils sont associés à des avalanches de sédiments, qu’on appelle des courants de turbidité. Une dynamique semblable à celle des avalanches de neige, mais sous l’eau.
En se déplaçant dans le fond marin, ces masses de sédiments posent un risque pour des infrastructures, dont des câbles de télécommunication.
[…]
Alexis Achim, récipiendaire d’une subvention Alliance du CRSNG
06 février 2023
Félicitations à Alexis Achim, professeur et vice-doyen à la recherche à la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, qui a décroché une subvention Alliance du CRSNG pour un projet multidisciplinaire sur la valorisation des filaments de cellulose!
Ce projet vise à soutenir le développement d'applications à base de filaments de cellulose qui seront destinées aux secteurs de l'agriculture, de l'hygiène et de la santé, de la construction et de l'environnement. Trois types de produits visent à être développés via ce projet :
- Bioproduits agricoles
- Papiers antimicrobiens
- Produits en béton
Des analyses du cycle de vie subséquentes permettront à ces nouveaux produits d’être comparés avec des produits conventionnels afin d'évaluer leurs performances environnementales.
Ce projet bénéficiera d’un financement de 746 788$ sur trois ans, dont 60% du montant proviendra de contributions publiques (40% du CRSNG et 20% du CRIBIQ) et 40% du partenaire industriel Kruger inc.
Équipe
Ce projet pourra compter sur la participation d’une équipe multidisciplinaire :
Équipe de recherche :
Alexis Achim (chercheur principal), CRMR, Université Laval
Tatjana Stevanovic, CRMR, Université Laval
Véronic Landry, CRMR, Université Laval
Alain Cloutier, CRMR, Université Laval
Benoît Bissonnette, CRIB, Université Laval
Nabil Amara, Faculté des sciences de l’administration, Université Laval
Julie Jean, FSAA, Université Laval
Annie Levasseur, ÉTS
Équipe de collaborateurs :
Rémy Lambert, FSAA, Université Laval
Sébastien Lange, CCTT Biopterre
Julien Bley, CCTT Innofibre
Un tourisme plus vert et plus diversifié à Québec
01 février 2023
Un bel l’article du média Le Carrefour de Québec, qui s'est entretenu avec Laurent Bourdeau, professeur au Département de géographie et spécialiste en tourisme sur le sujet du tourisme responsable au Québec.
« La Ville de Québec a toujours été une ville très touristique, mais comme ailleurs dans le monde, le tourisme a été affecté par la pandémie et la lutte contre les changements climatiques. C’est pour cette raison que l’on a pu constater des changements dans l’offre touristique et dans l’approche touristique qui inclut maintenant une réflexion écologique.
Pendant la pandémie, comme les frontières étaient fermées, il y a eu une grosse baisse du tourisme en l’absence des touristes internationaux. Cela a eu un impact positif sur le tourisme qui est devenu plus local, sauf pour des villes comme Québec ou Montréal puisque les touristes viennent principalement de l’international, explique Laurent Bourdeau, professeur au Département de géographie, spécialiste en tourisme, de l’Université Laval.
En effet, les retombées économiques du tourisme ont été moins grandes sans les touristes internationaux puisque ceux-ci dépensent plus que les Québécois. Il y a beaucoup d’entreprises (ex. : restaurants, hôtels, etc.) qui n’ont survécu à la pandémie que grâce aux subventions des gouvernements.
« La pandémie, ça nous a fait réaliser une chose : c’est qu’il y a des entreprises touristiques au Québec qui ont été débordées hors des grands centres urbains. Des régions comme l’Estrie, les Laurentides, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, où il y a eu une très forte fréquentation, parfois trop forte. » – Laurent Bourdeau [...] »
Les recherches de Patrick Lajeunesse dans le palmarès des découvertes de l'année de Québec Science
13 janvier 2023
Extrait du communiqué émis par l’Université Laval :
Des équipes de recherche de l’Université Laval ont contribué à 4 des 10 découvertes les plus importantes de l’année 2022 selon le magazine de vulgarisation scientifique Québec Science. La mise au point d’un tube vivant capable de faire repousser des nerfs sectionnés, les raisons pour lesquelles la dépression affecte différemment les femmes et les hommes, le lien entre les habiletés en langue parlée à l’enfance et l’écriture à l’adolescence ainsi qu’une meilleure estimation du risque sismique dans l’estuaire du St-Laurent font partie des percées qui ont obtenu la faveur du jury composé d'une dizaine de scientifiques et de journalistes.
Une meilleure connaissance du risque sismique dans l’estuaire du St-Laurent
Le professeur Patrick Lajeunesse, de la Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, et une équipe de l’UQAR dirigée par Guillaume St-Onge ont établi un portrait d’une précision inégalée de l’activité sismique dans l’estuaire du St-Laurent au cours des deux derniers millénaires. Après avoir analysé à l’aide de sondes sismiques le fond du fleuve entre Baie-Comeau et La Malbaie, les chercheurs ont prélevé des sédiments provenant de lieux où s’étaient produits des glissements de terrain au cours des siècles passés. La datation de ces prélèvements a permis aux chercheurs de déterminer que le fameux séisme de Charlevoix de 1663, d’une magnitude estimée à plus de 7, est le plus important à avoir frappé le Québec au cours des deux derniers millénaires. Les données recueillies permettent d’obtenir une meilleure connaissance du risque sismique de cette partie de l’estuaire, qui serait plus élevé que ce qui avait été estimé jusqu’à présent.
Lire l’article complet sur Québec Science
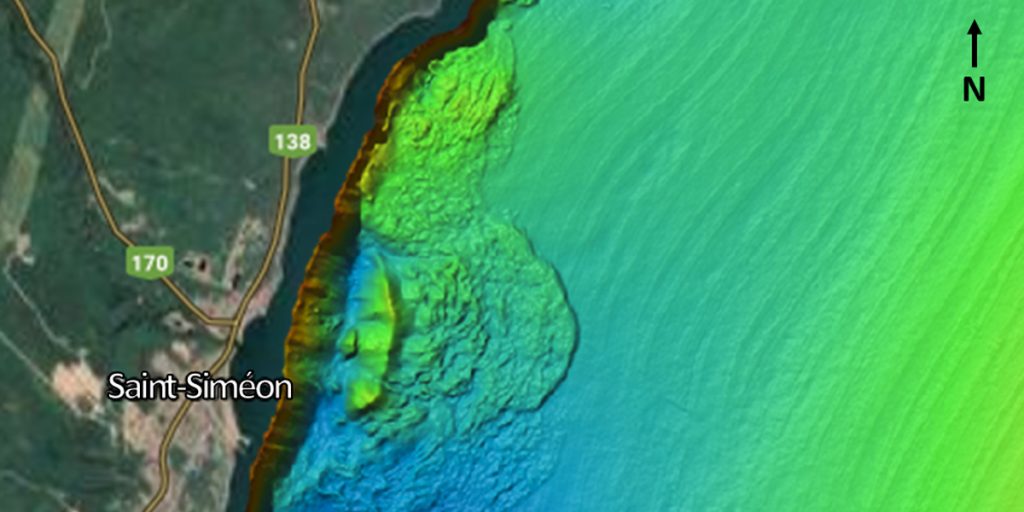
Ci-dessus : Image de Québec Science - La profondeur et le relief du fond du Saint-Laurent au large de Saint-Siméon ont été déterminés à l’aide d’un échosondeur multifaisceaux, permettant l’identification d’un important glissement sous-marin.